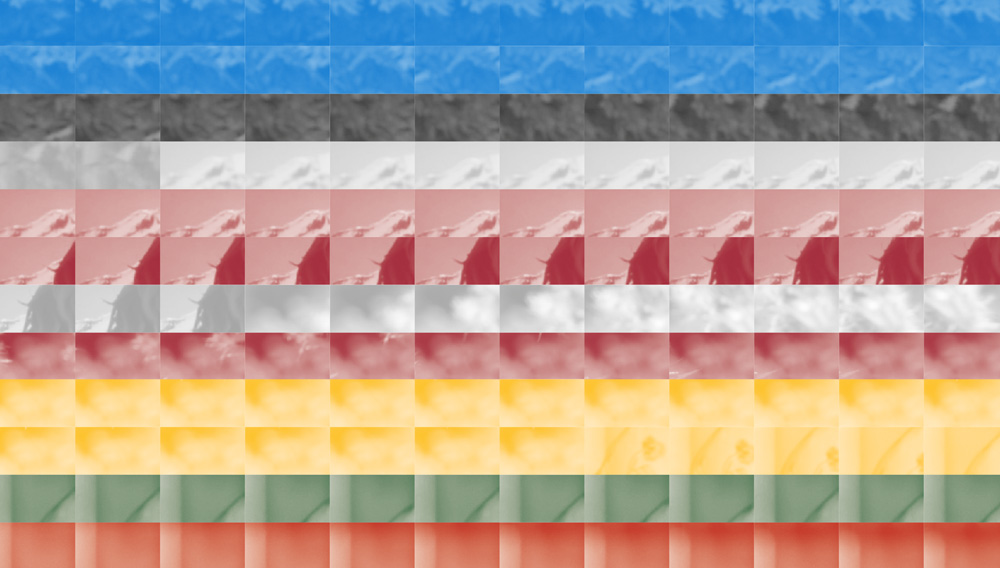Dans le très beau portrait radiophonique Je vous écrirai après ma mort, que lui a consacré Hélène Delprat pour France Culture (diffusé en 2018), Nicole Stéphane ne cesse de s’interroger sur l’intérêt et la pertinence de son témoignage. Un témoignage où se croisent pourtant les figures de Jean-Pierre Melville, Jean Cocteau, Luchino Visconti, Susan Sontag, Marguerite Duras, David Ben Gourion…, où les champs de bataille sont nombreux, tout comme les engagements. La trajectoire qui se dessine dans un XXe siècle houleux trace incontestablement une pensée en perpétuel mouvement. La valeur du témoignage est évidemment incontestable. On peut voir dans le questionnement de Nicole Stéphane une pudeur extrême, voire une forme de candeur, de celle qui empêche de se prendre trop au sérieux et rattache à la pureté des choses. « Je suis analphabète et immature, confesse abruptement Nicole Stéphane. Immature par rapport à la vie. Je suis encore dans l’enfance, dans l’adolescence... Je navigue... » C’est à cette aventurière qui a tenu la barre de son existence d’une main ferme que rend hommage la 43e édition du Festival de films de femmes de Créteil (2-11 avril 2021), avec une programmation de films où Nicole Stéphane se tient devant l’objectif (Les Enfants terribles de Jean-Pierre Melville, Monsieur et Madame Curie de Georges Franju...), mais aussi derrière, en tant que productrice (Détruire dit-elle de Marguerite Duras) ou réalisatrice (En attendant Godot à Sarajevo).
Une héroïne, une femme sublime ! »
« Ma cocotte ! », c’est ainsi que le cinéaste Jean-Pierre Melville appelait avec un mélange de condescendance et d’affection celle qu’il aura dirigée dans Le Silence de la mer (1948) et Les Enfants terribles (1950). La rencontre avec le futur réalisateur du Samouraï et de L’Armée des ombres est décisive. Dans Le Cinéma selon Jean-Pierre Melville, le cinéaste confie à Rui Nogueira :
Nicole Stéphane a alors tout juste 20 ans, une carrière d’actrice soudain placée sur les bons rails, mais pas du tout le profil de la jeune première innocente. Celle qui se retrouve propulsée sur un plateau de cinéma en cette fin des années 40 est déjà une combattante. Elle a intégré durant la Seconde Guerre mondiale l’École des Cadets de la France libre en Angleterre, créée par le général de Gaulle. Devenue sous-lieutenante, elle s’est occupée des prisonniers en Allemagne, a conduit indifféremment poids lourds, motos ou « chenillettes » et sait parfaitement se servir d’une arme à feu. Dans le portrait d’Hélène Delprat, Nicole Stéphane explique : « Je voulais être une héroïne, une femme sublime ! » Cette confession ne doit pas masquer le véritable engagement de cette jeune femme bien née – fille du baron James-Henri de Rothschild – ayant appris sur le tard sa judéité « à 16 ans ! », mais très tôt le sens du combat et du devoir. Celle qui donne la réplique à Howard Vernon et Jean-Marie Robain dans Le Silence de la mer puis à Édouard Dermit dans Les Enfants terribles a donc déjà un passé. Cela n’empêche pas un journaliste d’ironiser sur le changement de patronyme de la jeune comédienne et de titrer : « Pour devenir actrice, la fille de Rothschild fait vœu de pauvreté ! »
« Puissance effrayante ! »
Entre les deux films de Melville, elle part avec le chef opérateur Henri Decaë en Palestine, alors en pleine guerre, pour interviewer et filmer David Ben Gourion, le fondateur de l’État d’Israël (elle retournera sur place un peu plus tard avec une caméra pendant la guerre des Six Jours, puis celle du Kippour). Entre-temps, Melville l’a présentée à Jean Cocteau. L’écrivain et poète tombe sous le charme, insiste pour qu’elle soit son Élisabeth à l’écran tout en rêvant de mythologie grecque : « Les moindres gestes de Nicole Stéphane prenaient la puissance effrayante de ceux d’Électre », s’enthousiasme l’auteur des Enfants terribles. Peut-être, mais l’intéressée est déjà sur d’autres fronts. Productrice et réalisatrice plutôt qu’actrice. Derrière les lumières pour mieux guider les troupes. Des notes biographiques évoquent également un accident de voiture qui aurait précipité cette reconversion. À propos de Melville, Nicole Stéphane aimait à rappeler qu’elle n’avait pas hésité à le gifler un jour que le cinéaste s’était montré trop odieux avec elle. Résultat, douze ans de brouille.
La productrice initie et porte à bout de bras Mourir à Madrid (1963), documentaire engagé de Frédéric Rossif sur la guerre d’Espagne. Pour se rendre au-delà des Pyrénées avec toute son équipe, Nicole Stéphane cache à la police de Franco leurs véritables intentions et vante la réalisation d’un court métrage sur « L’Espagne éternelle ». Les portes s’ouvrent devant une censure aveuglée par ces vœux nationalistes. De cette pseudo-clandestinité, le film tire en partie sa force intrinsèque. Il y aura, juste après, l’éclosion de Jean-Paul Rappeneau avec La Vie de château, que Nicole Stéphane produit en 1966. L’une des grandes entreprises de sa vie est également l’adaptation d’À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Projet monumental qui, inconsciemment, renvoie l’intéressée à son enfance solitaire passée dans un cadre au faste crépusculaire. Luchino Visconti s’engage, puis c’est au tour de Joseph Losey qui s’appuie sur un scénario écrit spécialement par Harold Pinter... On pense aussi à François Truffaut, Jacques Rivette, ce sera finalement Volker Schlöndorff (Un amour de Swann, 1984).
Symbioses
Deux femmes ont particulièrement compté dans son parcours affectif et intellectuel. Marguerite Duras et Susan Sontag. Avec la première, elle produit Détruire dit-elle (1969) et s’enthousiasme de la façon dont les interprètes entrent en symbiose avec l’auteure de Moderato cantabile. Susan Sontag, qui a partagé sa vie, l’entraîne en ex-Yougoslavie au début des années 90. Le pays morcelé est alors en guerre. L’essayiste américaine adapte En attendant Godot de Samuel Beckett à Sarajevo. Nicole Stéphane parvient à convaincre une équipe de cinéma de se rendre sur place pour filmer les répétitions. Cela donnera le film En attendant Godot à Sarajevo, en 1993.
Cette femme qui aura toute sa vie sillonné le monde, se retrouvant toujours au cœur du cyclone, là où la guerre divise les peuples, est morte en paix le 14 mars 2007, à 83 ans. Ironie de l’histoire, elle disparaît le même jour que son amie Lucie Aubrac, grande figure de la Résistance. Dans le portrait d’Hélène Delprat, le mot « rêve » revient plusieurs fois dans sa bouche. Certains ont une vie, d’autres plusieurs.