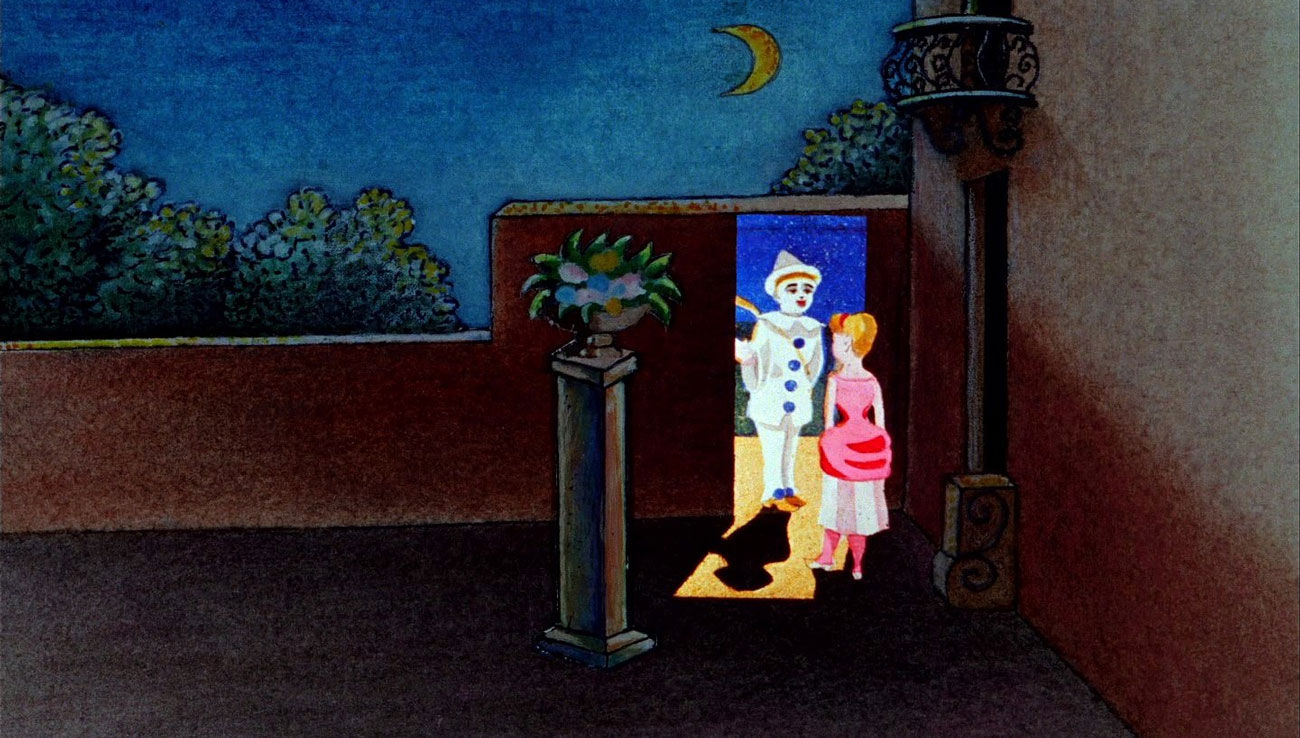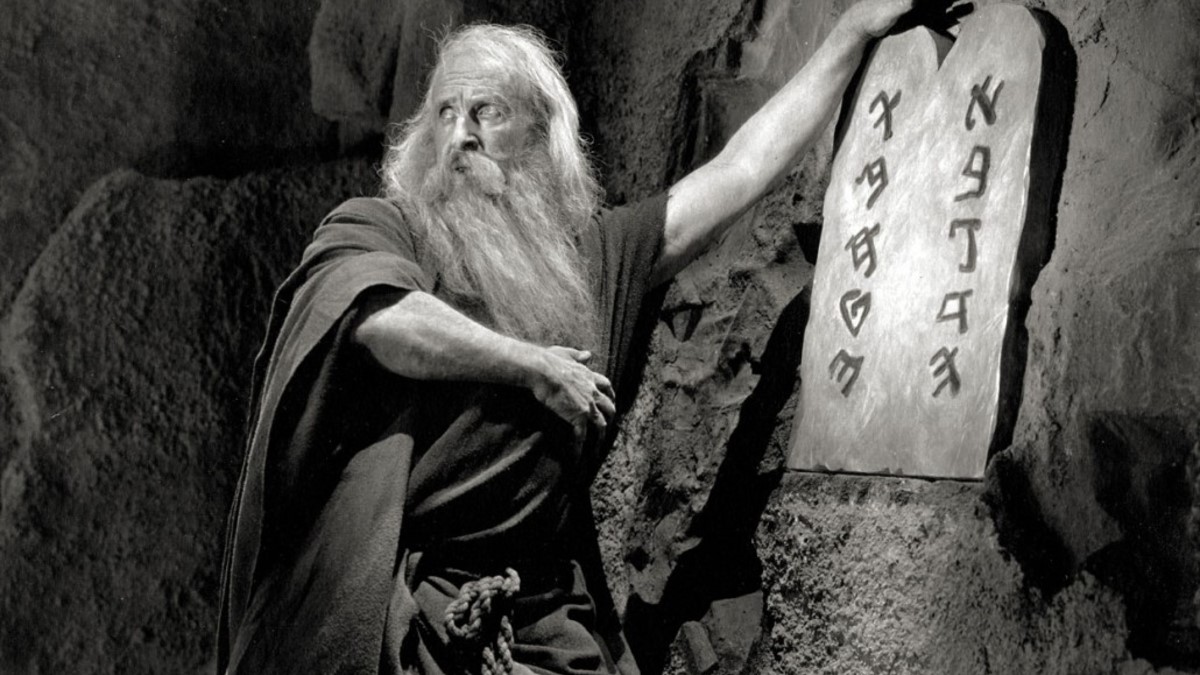On est à mi-parcours du festival, quel premier bilan tirez-vous de cette dixième édition ?
La grosse surprise pour moi, c’est Cayatte. Le nombre de personnes qui me remercient de leur montrer ses films, c’est inouï ! Ça prouve la pertinence de ce réalisateur longtemps déconsidéré. Les critiques de la
Nouvelle Vague et leurs héritiers avaient décidé de balayer Cayatte et on redécouvre un artiste qui s’était profondément intéressé à ce qu’il se passait en France à l’époque, dans le domaine de la vie quotidienne comme dans le fonctionnement des institutions. Ses films sont des témoignages irremplaçables sur les années 50-60. De Nous sommes tous des assassins au Dossier Noir (admirable observation sur le fonctionnement de la police), Cayatte a signé des films âpres, qui ne font pas de cadeaux, et les spectateurs comme les critiques d’aujourd’hui s’interrogent à juste titre sur le fait que Cayatte ait été proprement effacé de la mémoire collective. Parce qu’il faut rappeler qu’il fut très célèbre à une époque : il avait des prix dans les festivals, à Venise ou Cannes ; et il a disparu.
Comment l’expliquez-vous ?
On a eu peur. La presse a eu peur de ce qu’on a appelé son côté « film à thèse ». Mais c’est un procès injuste. Son cinéma dépassait largement cela ! Il avait des personnages très fouillés, vivants, parfois même atypiques. Dans Avant le déluge il met en scène un antisémite, il évoque l’homosexualité ; et il revient sur l’Occupation dans plusieurs de ses films avec une grande lucidité. C’était extrêmement rare à l’époque. Son style narratif était audacieux et il avait un talent formel indéniable… Je crois au fond que le problème était idéologique. Une certaine partie de la critique regardait avec méfiance ce cinéma « social ». C’est la Nouvelle Vague qui l’a ignoré et Doillon me rappelait il y a peu que, en dehors de Resnais et Varda, la Nouvelle Vague était constituée de personnalités plutôt marquées à droite… Ils ont toujours détesté le cinéma social, ce cinéma qui montrait toutes les facettes de la France – la paysannerie, les bidonvilles, les marges. A partir des années 60, la grande tendance du cinéma va consister à éliminer la classe ouvrière du tableau ! On va mettre une chape de plomb sur le monde populaire, ce monde décrit par Henri Verneuil, Julien Duvivier, Henri Decoin ou Claude Autant-Lara… Cayatte prend le relais. Pour que le cinéma s’intéresse de nouveau au peuple, il faudra attendre 68 et Cayatte fut l’une des grandes victimes de ce prisme idéologique. Je remarque par ailleurs que, aujourd’hui, les films qui font encore ce constat – ceux de Stéphane Brizé ou de Ken Loach – sont accusés d’être trop « sociologiques » ! On attaque ce cinéma parce qu’il parle de la réalité. Du réel. Mais je me réjouis de voir que les salles à Lyon où l’on projetait ses films étaient pleines.
Ce qui a également rempli les salles, ce sont les projections des films Pré-Code (avant le Code Hays de censure morale établi en 1930 par William Hays – sénateur et président de la Motion Pictures Producers and Distributors Association - et appliqué entre 1934 et 1966), la série « Forbidden Hollywood »…
Oui, ce fut l’autre choc de ce début de semaine. Je voulais qu’on montre 20 films, mais mes collègues programmateurs m’ont dit que c’était un peu trop (rires)… On s’est limités à 10. Encore une fois, les échos avec l’actualité la plus brûlante sont incroyables. Regardez Employee’s Entrance de Roy Del Ruth : pas une réplique qui ne s’applique à la situation sociale d’aujourd’hui. Sur le rapports entre les patrons et les employés, sur les banquiers, les capitalistes : c’est ATTAC ! Les films Pré-Code qu’on présente ont aussi étonné les spectateurs d’aujourd’hui par la place qu’y occupent les femmes : elles ont des rôles très forts et ça aussi c’est moderne.
L’autre événement, c’est la présence de monstres sacrés américains. Martin Scorsese, Francis Ford Coppola…
Mardi soir, le Scorsese a provoqué un grand choc émotionnel. J’adore The Irishman, je trouve que c’est un de ses plus beaux films parce qu’il touche à des émotions intimes que je ne lui connaissais pas. C’est un cinéaste de génie, avec une énergie remarquable, mais je ne le mettais pas dans la catégorie des cinéastes « émouvants ». L’énergie passait toujours avant. Il y avait bien un sentiment tragique, parfois de la nostalgie dans ses films, mais là, il y a une émotion intime inédite. La montée de la mort, la vieillesse… tout cela est totalement nouveau chez lui. C’est un film du renouvellement. Et puis comme vous le disiez, Coppola arrive. Je suis ravi qu’on l’accueille à Lyon et qu’on lui remette le Prix Lumière. Ce sera l’occasion de revoir les classiques, mais aussi de redécouvrir deux ou trois films qui me paraissent très sous-estimés. Jardins de pierre est très émouvant, un des rares films américains où l’on voit les conséquences de la guerre. Et Tucker ! On va revoir Tucker dans une copie 4K magnifique et on va découvrir à quel point il s’agit en fait de son film le plus autobiographique…
Au MIFC, le marché du film du festival, on entend les éditeurs rappeler que le Patrimoine est très vivant, et qu’il permet de mieux regarder le cinéma d’aujourd’hui et surtout d’être optimiste sur le futur du cinéma. C’est votre cas ?
Sur ce sujet, j’ai deux choses à dire : il faut d’abord sans cesse rappeler aux gens qu’ils doivent acheter des DVD de patrimoine. Gaumont, Pathé et bien d’autres éditeurs proposent des restaurations magnifiques de films essentiels et il faut encourager cette politique de restauration. La deuxième chose, comme vous le disiez, c’est que le patrimoine sert aussi à regarder vers le futur. Regarder des films et en faire n’a jamais été aussi facile qu’aujourd’hui. Je vois très fréquemment des quantités de bons films. Français, américains, asiatiques… Récemment, j’ai été très agréablement surpris par Fête de famille de Cédric Kahn ; j’ai beaucoup aimé le dernier Quentin Tarantino et regardez la qualité d’écriture du cinéma américain : Steven Zaillian, qui a écrit The Irishman, est un scénariste très doué. Je n’ai aucune crainte pour le cinéma. Les bons films sont toujours aussi nombreux qu’avant.