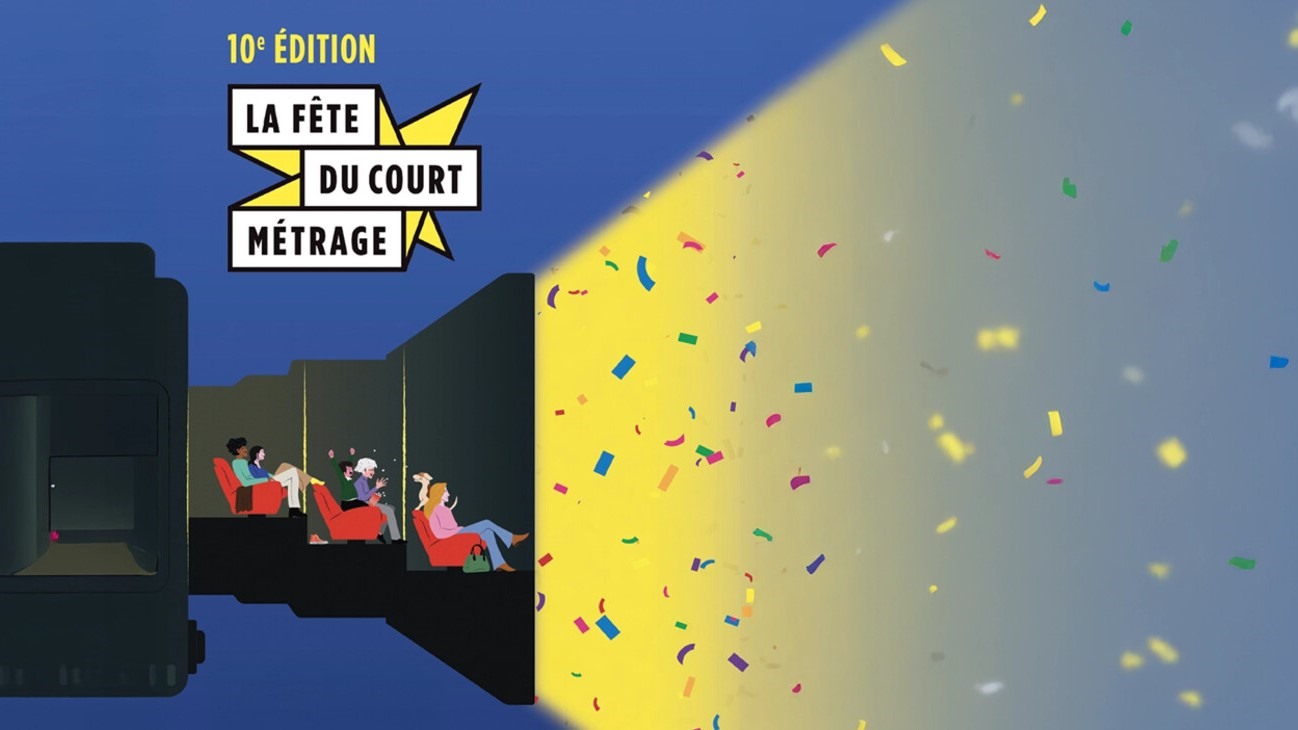Quelle a été votre enfance ?
Je suis né à Shanghai en 1982 mais je suis parti vivre au Canada, à l’âge de 10 ans. En Chine la révolution étudiante de 1989 avait rendu le contexte politique très difficile et incertain. Ma mère faisait alors ses études en Angleterre. Plutôt que de retourner en Chine, elle a préféré aller habiter au Canada où nous avions de la famille. J’ai donc grandi à Toronto. Le hasard a voulu que notre appartement se trouve juste au-dessus d’un cinéma de quartier. Un après-midi avec mon père nous sommes allés au cinéma. Nous ne parlions pas l’anglais. Je me souviens du film : Un joueur à la hauteur avec Kevin Bacon. C’était très mauvais mais j’étais fasciné par le côté américain : le basket-ball tout ça… A cette époque je voulais d’ailleurs changer mon nom pour faire plus américain. Mon grand-père chinois me l’a heureusement interdit.
Est-ce que vous étiez intéressé par la culture chinoise et spécialement le cinéma de votre pays natal ?
Très honnêtement, il a fallu attendre la fin de mes études de cinéma pour que je regarde enfin les films de Jia Zhangke, Hou Hsiao-hsien… J’avais 28 ans et jusqu’ici j’avais été nourri de blockbusters hollywoodiens. Toutefois, j’ai compris que si je voulais m’immerger dans ce pays que j’avais quitté à 10 ans, le cinéma pouvait offrir une fenêtre sur ce monde inconnu. Du coup, j’ai rattrapé mon retard et mon film de fin d’études était très influencé par le cinéma chinois des années 90.
A quel moment êtes-vous retourné en Chine ?
En 2005, j’y suis d’abord allé pour travailler. J’étais dans la finance à Shanghai. L’économie chinoise s’ouvrait alors au monde. C’était assez fou. Mais j’en ai très vite eu marre. La vie à Shanghai ne me plaisait pas et j’ai voulu connaître la vie en province. J’ai alors travaillé pour une grande marque de mode italienne qui avait une usine dans une ville plus petite. En 2008, à l’approche des Jeux Olympiques, beaucoup de sociétés de production occidentales voulaient tourner des documentaires sur la culture chinoise. J’ai commencé comme fixeur car je parlais bien anglais. Puis je me suis mis à en réaliser moi-même. J’ai attrapé le virus de l’image. Malheureusement, il était difficile de faire des films dans de bonnes conditions sur place. Je suis donc parti en Australie où j’avais des opportunités dans la publicité.
Votre premier long métrage, Old Stone (2016) parlait très durement de la société chinoise…
Au départ Old Stone, qui raconte la descente aux enfers d’un chauffeur de taxi, devait être tourné à Detroit aux Etats-Unis. Michael Shannon était intéressé mais je n’ai pas réussi à trouver les fonds nécessaires. Il se trouve que le gouvernement chinois cherchait à financer des films autour de personnages pris dans une spirale négative mais qui cherchent à refaire surface. Mon projet a attiré l’œil d’un producteur chinois et je l’ai donc tourné là-bas. Mais pour garder le final cut et éviter la censure, j’ai monté le film en dehors de la Chine. Bien-sûr le ton très sombre et désespéré de l’ensemble n’a pas beaucoup plu aux autorités. Ça ne l’a pas empêché d’avoir une belle vie dans des festivals internationaux.
Et Vivre et chanter ?
Quand j’ai rencontré cette troupe d’opéra qui essayait de perpétuer un héritage culturel tombé en désuétude, j’ai eu un choc. En effet, si Old Stone parlait de la dureté de la société, ces hommes et ces femmes m’offraient un autre regard sur la Chine, plus poétique, plus doux, plus humain. Ils gagnent tous une misère et pourtant ils continuent à créer, à monter des spectacles. Ils poursuivent leurs rêves et leur passion. L’opéra traditionnel de Sichuan a été jadis très populaire. Il y a quarante ans les membres de cette troupe auraient été des vedettes adulées dans tout le pays. Aujourd’hui, plus personne ne fait attention à eux, à part quelques nostalgiques. J’ai d’abord écrit un scénario d’une mini-série documentaire pour une chaîne chinoise autour de leur quotidien. Je suis resté sept mois à leurs côtés. J’ai commencé à écrire le scénario de Vivre et chanter en parallèle.
Que représente ce monde pour vous ?
C’est celui de mes grands-parents. Je me souviens qu’un cousin à moi, faisait de l’opéra. Il était le chouchou. J’étais un peu jaloux. Rendre hommage à cette troupe aujourd’hui partait d’un désir de rendre hommage à un monde oublié.
Vous avez engagé les vrais membres de la troupe ?
Ils jouent tous ici leurs propres rôles. Je n’avais aucune difficulté à les diriger car ils ont l’habitude de jouer. Ils étaient très heureux de se retrouver devant une caméra et de pouvoir défendre leur art. C’était très émouvant pour eux et pour moi.
Quelles ont-été vos influences ?
J’ai donc fait construire ce théâtre avec des couloirs. On pouvait l’investir comme on voulait et jouer avec. En même temps, je ne voulais pas que ce soit trop confiné. Il fallait que la vie puisse passer. L’autre influence est Les chaussons rouges de Michael Powell et Emeric Pressburger pour la virtuosité et le travail avec les couleurs. C’est la comédie musicale ultime.
Vivre et chanter, en salles le 20 novembre, a bénéficié de l’aide aux cinémas du monde et l’aide sélective à la distribution (aide au programme).