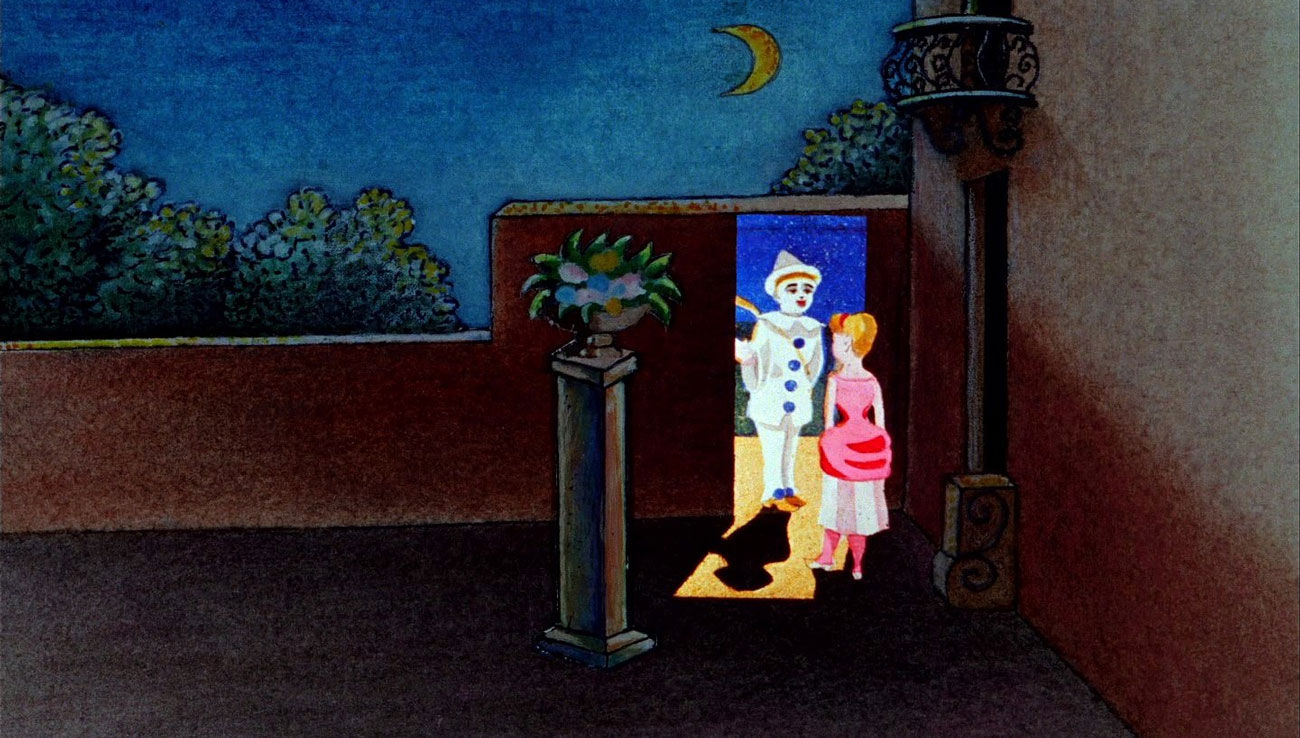Le Lit conjugal (1963)
Le Milanais Marco Ferreri, né en 1928, a construit son identité intellectuelle à Rome en délaissant des études de vétérinaire, peu conformes à l’idée qu’il se faisait de son existence, au profit d’une dolce vita artistique. Ferreri, baigné de néoréalisme et de comédie à l’italienne façonne sa propre personnalité de cinéaste au-delà des carcans. Il opte pour un humour noir et un nihilisme vachard. Après un début de carrière en Espagne, c’est bien en Italie qu’il va se faire un nom. Ce Lit conjugal, présenté au Festival de Cannes en 1963, permet à Marina Vlady de remporter le prix d’interprétation féminine. C’est une victoire pour le cinéaste qui a d’abord été accusé d’obscénité dans son pays. Dans une société encore très machiste et patriarcale, Ferreri montre comment une femme supposée innocente et pure aux jeux de l’amour devient une épouse aux désirs insatiables. Le mari littéralement écrasé sous les assauts répétés de sa femme est incarné par Ugo Tognazzi, fidèle parmi les fidèles du cinéaste. « Le thème du film est l’envie de procréer poussée à l’extrême, se réjouit Marina Vlady dans ses mémoires publiées chez Fayard. On fait l’amour jusqu’à épuisement pour perpétuer l’espèce, et ce dans un milieu ultra-catholique, une Rome dévouée corps et âme au Vatican, avec la bénédiction d’un oncle moine et de la sainte Église… Marco Ferreri s’en donne à cœur joie ! » Le cinéaste va dès lors enchaîner les films qui, à défaut d’être toujours de gros succès, ne passent jamais inaperçus. Il devient même avec Pier Paolo Pasolini l’un des auteurs italiens les plus extrêmes de son époque, figure de proue d’une contestation par le cinéma.
Dillinger est mort (1969)
Glauco, un ingénieur désabusé (Michel Piccoli), quitte son travail et rentre chez lui où l’attendent sa femme (Anita Pallenberg) et son employée de maison (Annie Girardot). Par hasard, Glauco découvre dans sa cuisine un revolver emballé dans un vieux journal qui annonce la mort de John Dillinger, célèbre truand américain de la Grande Dépression. À la sortie de ce film tourné en quatre semaines avec un petit budget, le cinéaste réaffirme son crédo : « Pour changer les choses, il n’y a pas de moyens tranquilles, il faut faire de la provocation, déranger. » Pour le héros du film ce « pas de côté » passe par le meurtre purement gratuit de sa femme et la possibilité de larguer les amarres vers des horizons ensoleillés. Pour le cinéaste, c’est la structure même de son film et sa narration qui surprennent : absence quasi totale de dialogues, répétition mécanique des gestes domestiques a priori anodins, plans-séquences reproduisant la durée réelle des actions… Dans son livre-essai L’expérience hérétique, Pier Paolo Pasolini, qui la même année a dirigé Marco Ferreri dans Porcherie, écrit à propos de Dillinger est mort : « Ferreri reproduit la réalité dans ses durées réelles par sadisme : c’est-à-dire que la durée réelle d’une action, dans sa reproduction, montre toute sa contingence. » Dillinger est mort est présenté en compétition au Festival de Cannes en 1969 où il est distingué par le prix de la meilleure histoire originale du Syndicat italien de la critique de film.
La Grande Bouffe (1973)
Le nom de Marco Ferreri est à jamais associé à ce film : un scandale à Cannes – et ailleurs – doublé d’un succès en salles (près de 3 millions d’entrées en France). La Grande Bouffe voit quatre amis issus de la bourgeoisie parisienne se goinfrer le temps d’un « séminaire gastronomique » dont la finalité est la mort. Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Philippe Noiret et Ugo Tognazzi se passent ainsi les plats dans un climat orgiaque et décadent. « Nous tendions un miroir aux gens et ils n’ont pas aimé se voir dedans. C’est révélateur d’une grande connerie », s’agace Noiret en marge du Festival de Cannes, ce qui n’empêche pas le film de recevoir le prix FIPRESCI ex aequo avec La Maman et la Putain de Jean Eustache. « L’époque de La Grande Bouffe est celle où la bourgeoisie n’est pas vraiment en mesure de se regarder mourir, analyse aujourd’hui Gabriela Trujillo dans son essai Marco Ferreri : Le cinéma ne sert à rien (Capricci). D’où, peut-être, l’indignation et le tapage autour de la sortie du film. Les personnages, quant à eux, ne sont jamais épuisés, juste élégamment ennuyés ou las, trop vieux et trop riches pour se révolter. »
Touche pas à la femme blanche ! (1974)
Si La Grande Bouffe incarne le versant populaire d’une carrière qui n’a jamais cherché à l’être, Touche pas à la femme blanche !, tourné dans la foulée, en est le pendant tourmenté. Son échec public (230?000 entrées en France) malgré son rutilant casting (Mastroianni, Piccoli, Deneuve, Reggiani, Noiret…) s’explique peut-être par le manque de clarté sur son identité. Touche pas à la femme blanche ! se veut un western autour de la fameuse bataille de Little Bighorn qui, en 1876, opposa l’armée américaine emmenée par le lieutenant-colonel Custer (Marcello Mastroianni) à des Sioux et des Cheyennes. Le titre volontairement provocateur semble dire autre chose. Il traduit en réalité l’interdiction faite au guide indien de Custer (Ugo Tognazzi) d’approcher la prude Marie-Hélène de Boismonfrais (Catherine Deneuve). En se focalisant sur cet aspect, Ferreri dénonce bien entendu le racisme de la société – d’hier et d’aujourd’hui – et des inégalités sociales qui voient des héros supposés dominer les sans-grade. Le film fut tourné en plein Paris, dans le « trou » des Halles qui offrait alors une sorte de désert urbain au milieu de la capitale. Le scénario oscillant entre satire sociale et fable politique prend l’allure d’une comédie iconoclaste de haut vol. Ferreri qui clamait que son film s’adressait « à tous les enfants du monde », dut s’incliner face au désaveu des spectateurs. Finies donc la démesure et les reconstitutions historiques délirantes. Cela n’empêchera pas le frondeur Ferreri de continuer à ruer dans les brancards.
Rêve de singe (1978)
C’est peut-être l’un des scénarios de Ferreri les plus ambitieux. Rêve de singe a été coécrit notamment avec Gérard Brach qui s’était alors fait un nom grâce à sa fructueuse collaboration avec Roman Polanski. Ce « rêve » qui a tout du cauchemar raconte le quotidien de Lafayette, un électricien new-yorkais (Gérard Depardieu). Sa morne existence se réduit principalement à trois lieux : un musée de cire, un théâtre dirigé par des féministes qui mettent en scène une pièce sur le viol d’un homme dont Lafayette fera bientôt les frais, et son appartement vétuste infesté de rats. Lors d’une escapade près de l’Hudson River, il découvre la carcasse d’un singe en carton-pâte, bouleversant un peu plus son existence contrariée. Au sein de l’« arrogante » société capitaliste dont New York serait à la fois le temple et le sanctuaire, Ferreri signe un film violent, virulent mais rehaussé par une poésie évidente. « Certains pensent que je suis un cinéaste cynique et négatif, commente le réalisateur dans les colonnes de Télérama à sa sortie. En réalité, je crois en l’animal homme, et je lutte pour que l’homme trouve sa nouvelle place dans le groupe. Il s’agit, au fond, d’avoir à construire (…) une société de base, où les hommes n’auront plus à mandater les autres pour décider ce que doit être le rapport humain et social. » Rêve de singe est remarqué au Festival de Cannes où il remporte le Grand Prix spécial du jury confirmant la place importante qu’occupe Ferreri dans le cœur des cinéphiles. Marco Ferreri continuera tout au long des années 80 et jusqu’au début des années 90 à signer des films irrévérencieux et inspirés (Conte de la folie ordinaire, Le Futur est femme, Y a bon les Blancs…). L’un de ses derniers opus connus est un moyen métrage en hommage à Rabelais en 1993. La boucle semble bouclée. Marco Ferreri meurt le 9 mai 1997 à seulement 68 ans.
Ressortie en salles et en vidéo du Lit conjugal, Dillinger est mort et Le Mari de la femme à barbe (Tamasa Distribution)