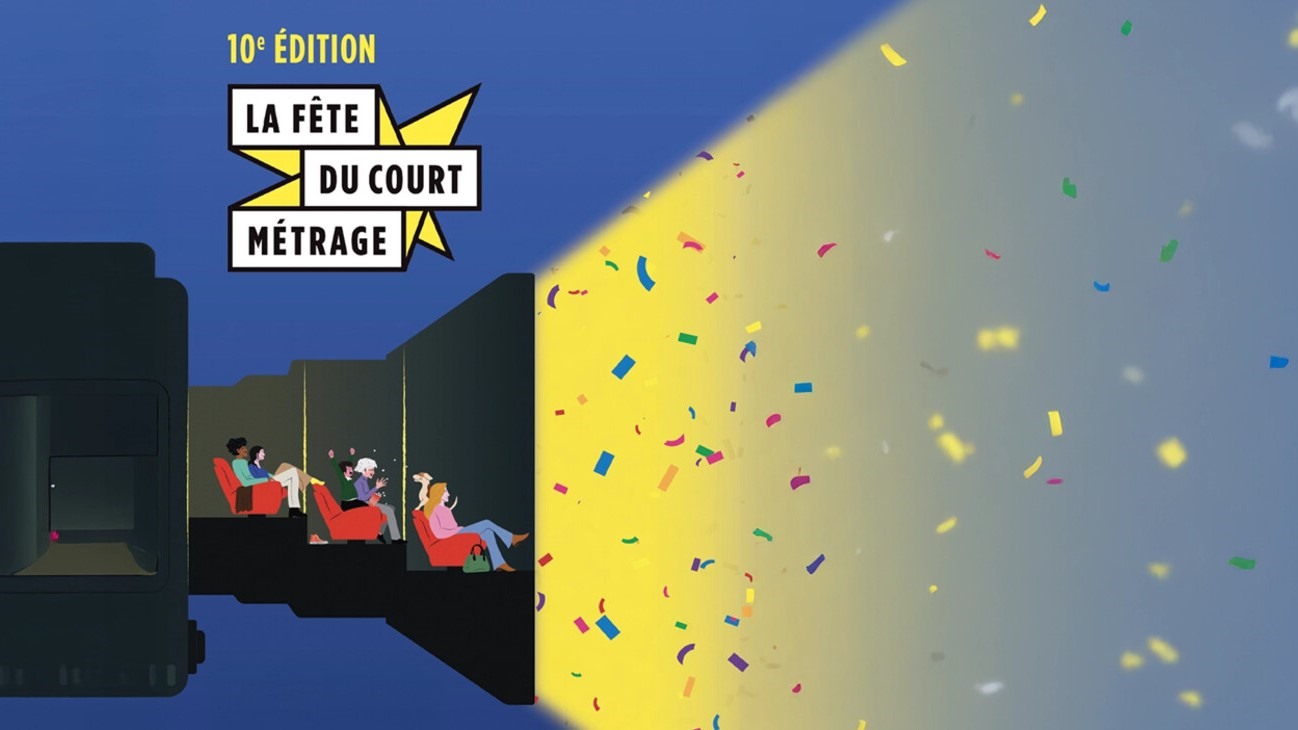Est-ce que les attentats du 13 novembre 2015 à Paris ont déclenché l’écriture d’Amanda?
Les choses s’agrègent toujours de façon plus ou moins consciente. Il m’est difficile d’affirmer que les attentats ont suscité un désir immédiat de fiction. Ce qui est sûr c’est que je voulais filmer Paris au présent et par là même, saisir une atmosphère que ces terribles évènements ont modifiée. Il y a des blessures, une fragilité, une électricité particulière, qui correspondent à notre époque. Sur le plan de l’espace aussi les choses ont changé : les patrouilles de militaires dans les rues, les blocs de béton qui enserrent les espaces piétonniers. Le simple fait de poser sa caméra nous fait voir des choses qui n’étaient pas là il y a encore trois ans.
D’autant que l’action du film se situe non loin des véritables lieux de ces attentats…
Effectivement. On peut apercevoir par exemple le bar La Belle Equipe dans le fond du cadre. Ce Paris que je filme ici est jeune, cosmopolite, ce n’est pas un hasard s’il a été la cible des terroristes. Il reste encore authentique, différentes classes sociales cohabitent, on y trouve aussi un mélange architectural… J’avoue que j’ai d’abord freiné des quatre fers à l’idée d’intégrer les attentats au récit. Et puis, par le prisme de la tragédie intime, j’ai eu l’impression que la fiction pouvait prendre le relais et témoigner de cette douleur.
Comment parvient-on justement à trouver la bonne distance pour évoquer une telle brutalité ?
Il était hors de question par exemple de partir d’un des attentats existants. Il ne s’agit pas ici de la guerre des tranchées avec des millions de morts, on peut mettre un visage, un nom, sur chacune des victimes de ces attentats. Il aurait été indécent d’en inventer une. J’ai donc essayé de trouver un espace moins identifié, moins connoté, de déplacer légèrement les choses pour me les réapproprier, ce qui posait d’autres problèmes moraux. Le bois de Vincennes, m’est alors apparu comme le plus juste, puisque que l’idée de forêt referme en elle une part d’abstraction, presque de l’ordre du conte. En même temps, c’est un lieu de détente, de partage, qui de fait, pourrait servir de cible…
La lumière douce avec laquelle vous filmez atténue cette violence…
Oui mais je ne pouvais pas trop édulcorer les choses non plus. Il fallait représenter les victimes avec une certaine vérité. Les images sont très crues, je montre des corps mutilés, blessés, il y a du sang… Tout ça est vu à travers le regard du personnage joué par Vincent Lacoste dont on peut se demander si les images de ce carnage ont eu le temps d’accéder à son cerveau. Lorsque l’on est saisi par quelque chose de très violent, il arrive que le cerveau crée un petit décalage qui permet de ne pas être enseveli sous le poids du réel.
Quels sont les autres éléments qui ont déterminé l’écriture ?
Depuis longtemps j’avais en tête l’image de deux enfants avec le plus grand qui tient la main du plus petit pour le guider, l’accompagner. Une disparition serait à l’origine de ce rapprochement. Très vite m’est donc venu le thème de la paternité. Un jeune garçon devient tout d’un coup père, presque accidentellement. Il n’y est pas préparé.
Dans vos précédents films comme dans celui-ci, il y a toujours cette idée d’espace périphérique, d’une frontière qui n’est pas loin… Pourquoi ?
C’est très intuitif. Il y a sûrement derrière ça, la promesse de quelque chose, d’un ailleurs, qu’un échappatoire est possible. Se situer loin du centre de gravité me permet d’observer sans être dans l’œil du cyclone. J’aime cette position, c’est une question de sensibilité, de pudeur. Je cherche à atteindre des sentiments, des faits, tout en gardant une certaine distance.
Cela se traduit également dans un rapport de force constant entre la solitude des personnages qui semblent évoluer dans une bulle et le rappel à l’ordre du réel lorsqu’ils se retrouvent au milieu d’une foule, comme lors de la séquence de la gare par exemple…
Après un drame, nous sommes totalement absorbés par notre peine et pourtant tout autour, le monde ne s’est pas arrêté. C’est étrange comme sensation, presque rassurante au fond. Paradoxalement, ça renforce la solitude. La séquence de la gare exprime ça. Idem lorsque je fais des plans d’un Paris « carte postale » mais vidé de ses touristes. C’est étrange donc brutal. Puis sur la Seine on voit passer un bateau-mouche rempli de monde. L’air de rien, la vie reprend ses droits…
Le film a été tourné en pellicule Super 16 mm, un format qui parait obsolète à l’heure du tout numérique. Pourquoi ce choix ?
C’était déjà le cas pour mes deux précédents longs métrages. J’aime ce rapport à la matière, aux couleurs. Il y a aussi quelque chose d’imparfait dans l’image qui me séduit. On a la sensation de pouvoir la toucher, à l’inverse de ces images numériques ultra-parfaites. De manière inconsciente, il y a aussi quelque chose d’un peu sacré avec la pellicule, il faut la développer, l’image s’imprime, se révèle peu à peu.
La musique est très présente dans Amanda. Elle est signée par un américain, Anton Sanko…
Il vient du rock. Il a longtemps travaillé avec Suzanne Vega, dont il a écrit et orchestré les plus grands tubes. C’est en voyant le film Rabbit Hole de John Cameron Mitchell dont il a signé la musique, que j’ai découvert son travail. J’avais d’ailleurs plaqué la bande originale du film sur le premier montage d’Amanda. Assez logiquement, j’ai essayé de le contacter. Il a vu le film et s’est mis au travail tout de suite. Sa musique utilise beaucoup de cordes, de l’ukulélé mais aussi des violons, des violoncelles… Je voulais des morceaux assez minimalistes et d’autres plus enlevés, plus lyriques. Il fallait que j’assume le côté mélo de mon film. Avant, j’avais tendance à occulter la musique dans les séquences d’émotion pour ne la loger que dans les moments de creux. Je sais que l’on dit souvent avec ironie que : « les violons ont toujours raison », mais j’assume, ça fait partie du cinéma.
Si le film porte le prénom de la petite fille Amanda, le vrai héros c’est David, incarné par Vincent Lacoste. Vous avez écrit le film pour lui ?
Non, au départ, le personnage devait être plus âgé mais j’aimais l’idée de ce jeune père avec un pied encore dans l’enfance. Vincent apporte ce côté d’adulte un peu gauche. Mais derrière cette apparente nonchalance, il y a un vrai bosseur. Il a une justesse de ton immédiate qui n’a pas nécessité un travail de direction d’acteur spécifique. C’était intéressant de le mettre face à quelqu’un comme Stacy Martin qui elle a besoin de tout connaître de son personnage pour l’incarner. J’aime aussi le visage de Vincent, il a un côté solaire qui illumine d’emblée le cadre.
Ce qui convient plutôt ici, puisqu’Amanda est un film d’été…
Oui, c’est la saison du renouveau, la saison lumineuse par excellence. L’absence y est d’autant plus déchirante.
Amanda sort en salles le 21 novembre 2018. Le film a bénéficié de l'Avance sur recettes avant réalisation