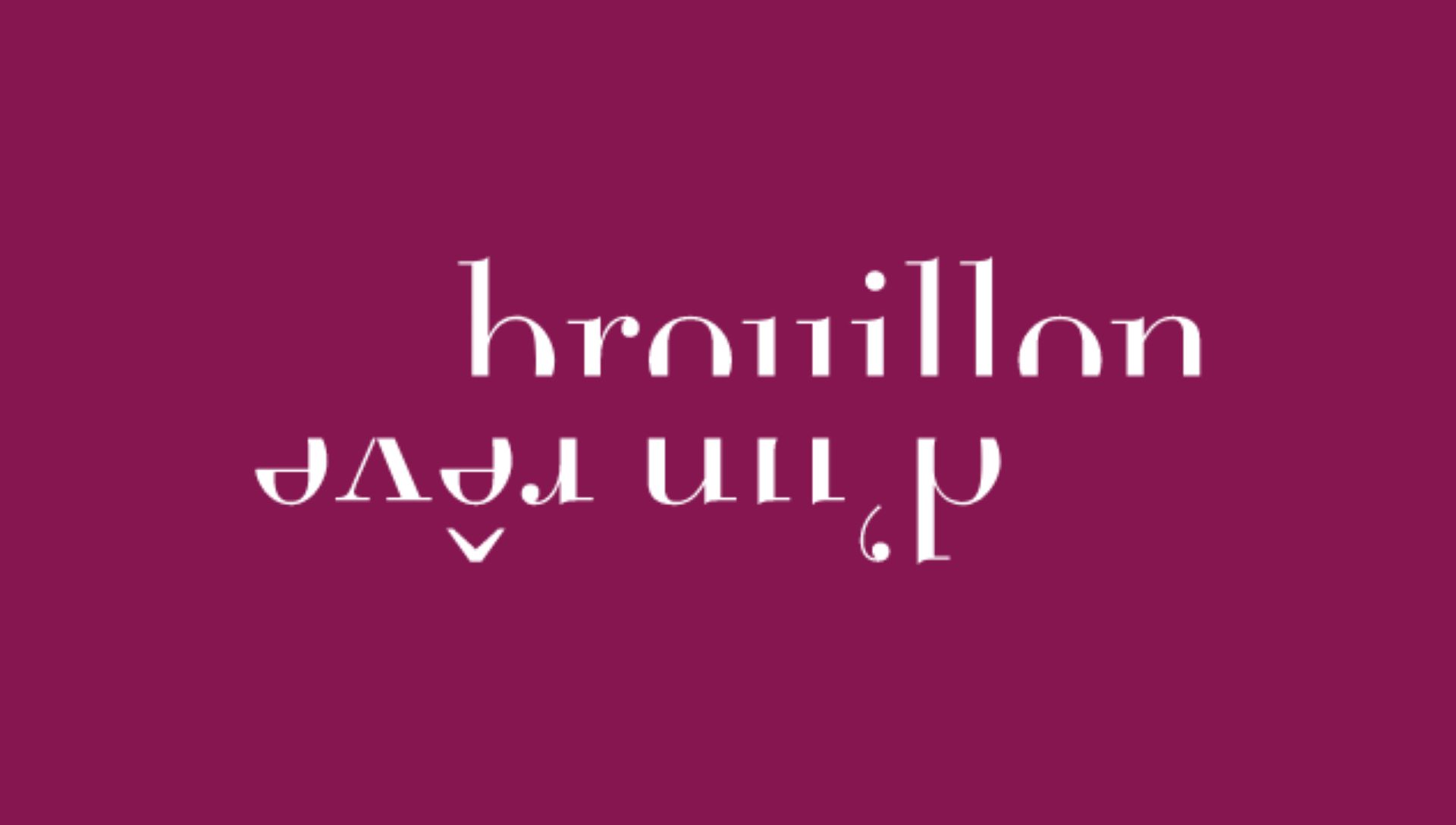Quel a été le premier déclic pour ce documentaire ?
Sandrine Mercier : Juan (Hidalgo) et moi avons vécu en Espagne pendant quatorze ans. Et à l’été 2020, nous sommes revenus dans notre petit village du Sud-Ouest, en compagnie de nos cousines d’Andalousie qui sont tombées immédiatement sous le charme un peu folklorique des soirées festives entre bandas, lampions… Elles nous ont posé une question qui a agi comme un déclic : que se serait-il passé si nous étions restés là ? Cette question en a tout de suite fait naître une autre : pourquoi, à l’adolescence, nous est-il apparu important de partir de ce village pour « réussir notre vie » ? Car, à 18 ans, je n’avais qu’un objectif : quitter ce que je surnommais « la cambrousse ». Avant qu’adulte, en revenant tous les étés avec nos enfants, je mesure la force de l’attachement à ma terre natale. C’est ce qui nous a donné envie de réaliser Se souvenir des tournesols.
Comment s’est opéré le choix du village gersois de Nogaro comme cadre du film ?
Notre idée a tout de suite été de partir d’une adolescente – mon alter ego en quelque sorte – que nous allions suivre l’année du baccalauréat, qui constitue pour elle un moment de bascule. C’est le temps des premiers choix et du passage à l’âge adulte, à travers ce moment où elle doit quitter son village faute d’établissement d’enseignement supérieur à proximité. À travers elle, nous souhaitions dénoncer les inégalités territoriales. Pour trouver le village en question, nous avons fait des repérages qui nous ont servis de « casting » sans que personne ne le sache, notamment au sein des bandas, ces fanfares si caractéristiques du Sud-Ouest. Parce que la banda constitue une sorte de microsociété, mêlant les générations et les situations sociales. Elle est ouverte à tous. Faire partie d’une banda, c’est une façon de s’intégrer au village, d’oublier son quotidien. C’est aussi une forme de première reconnaissance, car tout le monde vous identifie avec votre costume et vous connaît. Au fil de ces repérages dans le Gers, Nogaro s’est rapidement imposé.
Pour quelle raison ?
Pour ses décors magnifiques, mais aussi parce qu’il se situe en pleine « diagonale du vide ». À deux heures de route de Bordeaux comme de Toulouse. À une heure de l’hôpital le plus proche. Une fois sur place, nous allons rencontrer Anaïs, notre « héroïne », par l’intermédiaire de la banda de Nogaro et plus précisément de son chef d’orchestre, Thierry, avec qui j’ai eu un vrai coup de foudre amical. Après un long échange téléphonique, il nous a invités le week-end suivant à une fête du village. À peine arrivés, nous nous sommes sentis adoptés, nous avons partagé la salade de riz avec tout le monde… Avec Juan, nous voulons toujours que les gens connaissent tout de suite la raison de notre présence : la fabrication d’un film. Il est essentiel que tout soit clair dès le départ. Alors nous avons expliqué à nos interlocuteurs le documentaire que nous voulions faire. Notre envie de les mettre en lumière et de raconter les territoires autrement, cette fameuse « diagonale du vide », par le biais de la musique.
Qu’est-ce qui vous frappe quand vous commencez à filmer ?
Nous voyons tout de suite à quel point Thierry est animé par ce qu’il fait, et que par ricochet, il ne fait pas attention à notre présence. Ce qui est parfait pour nous. Son seul objectif est que ces gamins jouent harmonieusement. Nous remarquons aussi deux jeunes filles qui s’apprêtent à passer le bac. Clara et Anaïs. Les deux acceptent que nous les filmions. Mais nous percevons rapidement chez Clara une forme de réticence. Alors qu’elle nous avait dit oui, son corps, lui, disait non. Elle avait toujours une mèche de cheveux qui lui barrait le regard… Tandis qu’Anaïs faisait sa vie sans se soucier de nous. Ce fut alors une évidence qu’elle serait notre héroïne et mon alter ego.
Avez-vous été immédiatement acceptés par cette banda ?
Oui, ils nous ont même habillés comme eux. Moi à la perche pour le son et Juan à la caméra. « Nos instruments », comme ils nous disaient en rigolant. Pendant plus d’un an, nous avons déambulé avec eux, comme si nous faisions partie intégrante de la fanfare.
Ce qui frappe en découvrant Se souvenir des tournesols, c’est son côté solaire alors qu’il traite de thématiques plutôt graves. Était-ce un parti pris ou la conséquence de ce que vous avez pu observer et filmer ?
Au départ, nous avions en tête quelque chose de moins solaire, sans pour autant vouloir verser dans le misérabilisme. Nous entendions en tout cas casser certains clichés, montrer des personnes qui vivent bien sur place, sans avoir l’idée de partir. En fait, nous étions d’emblée convaincus que cette question de partir ou de rester était souvent un faux choix mais qu’elle donnait naissance à une autre interrogation qui nous passionnait : peut-on revenir quand on le veut ? Car derrière ce questionnement, se cache tout ce qu’on voulait dénoncer : l’absence de gare, de médecins, d’emplois… Nous souhaitions créer une sorte d’indignation que la beauté des décors allait amplifier. Car c’est évidemment plus dur de quitter un endroit magnifique où on a l’air de bien vivre et encore plus insupportable qu’on ne puisse pas y rester si on en a envie. Et puis, une fois sur place, nous avons vraiment été frappés par l’attachement des plus jeunes, dont Anaïs, à cette terre, à leurs racines, que je n’avais pas ressenti à mon époque. Le côté lumineux que vous évoquez épouse ce sentiment-là. Dans les années 1980, mes amis et moi n’avions qu’une envie : nous enfuir au plus vite. Ces jeunes sont, au contraire, contraints de partir pour poursuivre leurs études mais veulent tout faire pour essayer de revenir. Ça les fait peut-être rêver un peu moins grand. Mais leur liberté est, elle, bien plus immense. C’est ce que nous avons essayé de montrer, aidés en cela par le côté solaire et doux que dégage Anaïs.
Combien de temps a duré le tournage ?
Il s’est étalé sur un an, entamé par la taille des vignes et clos avec les vendanges. Même si, à ce moment-là, il nous manquait la scène finale. Nous avions en effet décidé d’utiliser une musique originale et nous tenions absolument à ce que la banda de Nogaro l’interprète. Un sacré défi pour le compositeur Olivier Cussac qui a l’habitude de travailler avec des orchestres symphoniques et pas avec des amateurs, dont certains ne savent pas lire une partition. Mais il a tout de suite accroché à cette idée. Nous avons logiquement attendu que la banda maîtrise le morceau avant de tourner cette séquence à l’intérieur du cinéma du village. Un moment vraiment très émouvant à vivre.
Pourquoi avoir fait appel à Olivier Cussac ?
Nous avions déjà travaillé avec lui à l’occasion d’une série documentaire pour France Télévisions sur l’usine AZF qui a explosé à Toulouse en 2001 et nous sommes restés amis. Et puis ça nous importait d’essayer de fabriquer un film qui soit, pour une fois, quasiment à 100 % réalisé en Occitanie où nous vivons. Olivier Cussac est compositeur à Toulouse, où il travaille notamment pour les studios d’animation TAT. Et puis il possède ce côté très pédagogue indispensable à ce que nous souhaitions et a eu envie de célébrer tous ces musiciens amateurs rarement mis en lumière.
Au fil de cette année de tournage, qu’est-ce qui vous a le plus surpris, bousculés ?
Nos films sont toujours très écrits. Comme nous tournons en optique fixe, nous essayons à chaque plan de faire des tableaux où nous décidons en amont de notre cadre. Même si, évidemment, nous ne répétons jamais la moindre scène et aucun dialogue n’est écrit. Ce qui est magique dans le documentaire, c’est ce moment où les gens que nous avons choisis en deviennent les protagonistes. Ici, tout a été chamboulé par un événement tragique : la mort d’un très proche collaborateur de Thierry qui a succombé à une maladie foudroyante en quelques mois. Nous nous sommes évidemment demandé si nous devions le garder dans le film. Mais ça affectait tellement Thierry qu’il était impossible de ne pas le faire, d’autant plus que nous avons vu à son enterrement à quel point la musique fédérait une solidarité : tous les musiciens des écoles de musique du Gers se sont regroupés en 48 heures. Dans la même semaine, nous avons appris que Noémie, autre bras droit de Thierry, était prise à l’école de musique de Blagnac où elle avait postulé et qu’elle allait devoir partir. Tout cela, on ne peut pas l’écrire. Ce sont des moments qu’on saisit. En fait, on écrit vraiment un film trois fois : au scénario, au tournage et au montage.
Comment s’est fait le montage, justement ?
Nous avons souhaité construire la dramaturgie autour de trois personnages principaux. Anaïs, évidemment, qui figure le regard du spectateur. Thierry, qui est resté par foi et par engagement et qui, la première fois que nous l’avons vu, nous a dit qu’il voulait être un musicien de campagne, comme il y a des médecins de campagne ! Et puis Éric, l’agriculteur-viticulteur qui, lui, est parti avant de revenir quand il s’est rendu compte qu’il voulait transmettre la terre de ses parents à son fils. Notre travail au montage a consisté à relier ces trois lignes pour qu’elles se superposent de manière fluide et dialoguent entre elles.
Avec un an de rushes, il y avait de quoi donner naissance à une série documentaire. Comment avez-vous réussi à concentrer les choses en 90 minutes ?
En essayant précisément de ne pas aller trop vite, de rester dans ce temps lent qui est celui de la nature. Nous avons vraiment été portés par les éléments. À commencer par les tournesols qui donnent le titre au film et que nous avons personnifiés tant ils sont incroyablement cinégéniques. Une seule image suffit à comprendre que lorsqu’ils sont fanés, c’est le temps du départ. Se souvenir des tournesols suit le compte à rebours inéluctable de la nature. Un rythme qui épouse celui du village, contre lequel il ne fallait absolument pas que le film aille !
SE SOUVENIR DES TOURNESOLS

Réalisation : Sandrine Mercier et Juan Hidalgo
Production : VEO Productions
Distribution : Bodega Films
Sortie le 14 mai 2025
Soutien sélectif du CNC : Aide sélective à la distribution (aide au programme 2025)