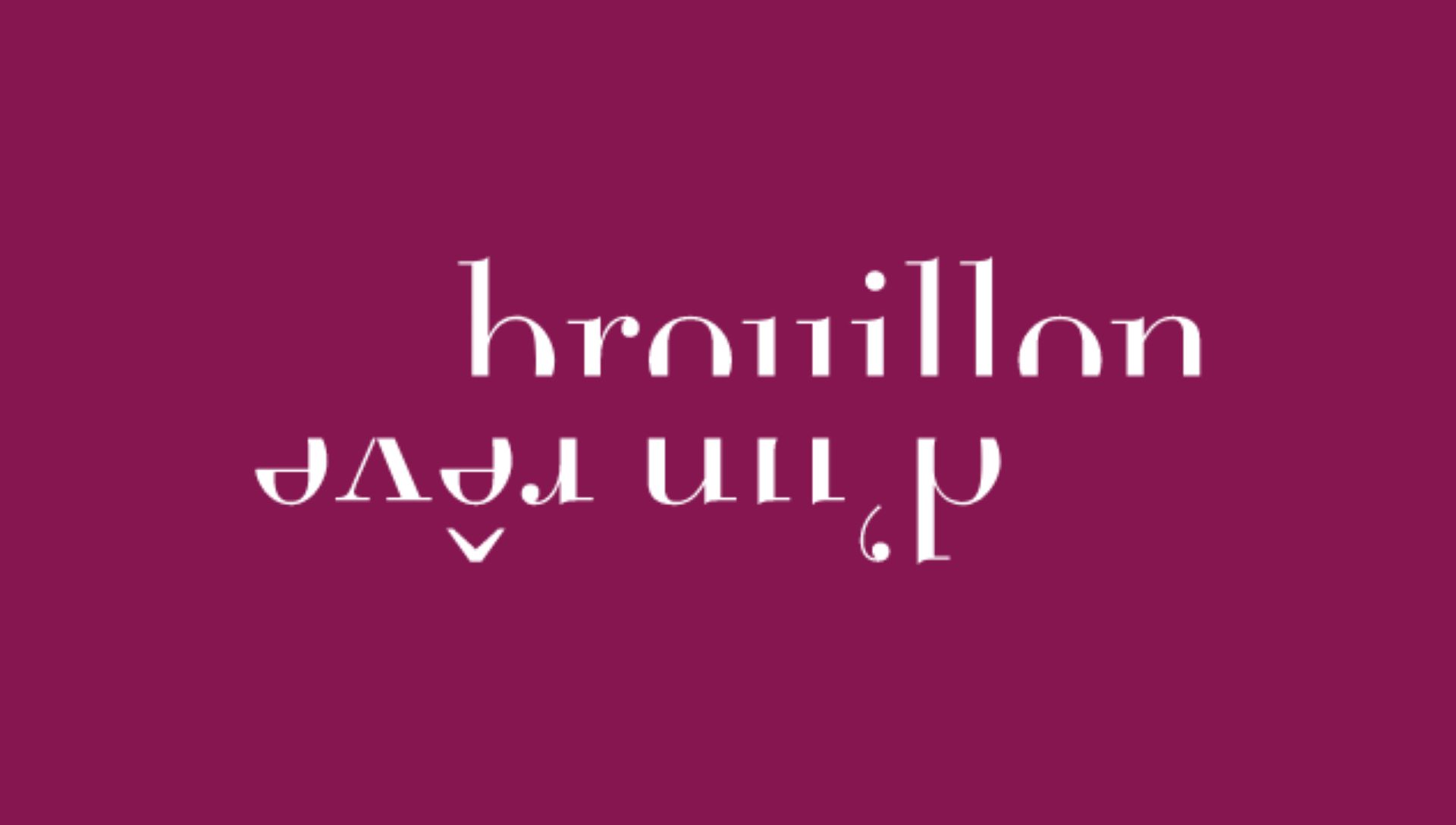Comment ce documentaire est-il né ? Avez-vous été sollicité par le photographe Laurent Ballesta ?
Yann Rineau : Oui, c'est souvent ainsi que l’aventure commence : tout démarre d'une plongée de Laurent Ballesta et de son initiative. Je travaille dans son équipe depuis trois ans. J'avais réalisé un premier documentaire avec lui, Les Mystères du mont La Pérouse, un 52 minutes pour Arte. J'étais également le binôme du réalisateur Gil Kebaili sur Planète Méditerranée. Lorsque Laurent, qui est aussi producteur, a souhaité créer un film sur ces anneaux découverts au large du Cap Corse, il m'a contacté pour le réaliser. Initialement, nous envisagions un 52 minutes, pensant résoudre l'énigme en un an. Finalement, cette aventure s'est étendue sur trois années. Ce film s'est construit progressivement, au gré des découvertes scientifiques et des expéditions. Le documentaire d’enquête est généralement un format difficile à écrire en amont, mais dans ce cas, les rebondissements se sont succédé.
Comment avez-vous appréhendé le tournage dans ces profondeurs ?
J'ai découvert les formations circulaires via les clichés pris par Laurent lors de sa première immersion. À 120 mètres sous la surface, la plongée en saturation devient incontournable. Dans cette zone du Cap Corse, le milieu est particulièrement agité, exposé à tous les vents, ce qui complique considérablement l'opération. Cette technique nécessite l'utilisation d'une grande barge avec un module où plongeurs et scientifiques vivent confinés durant 21 jours. Ils subissent une seule pressurisation, évitant ainsi les allers-retours et les temps de décompression requis. En 2021, première année de tournage, nous collaborions essentiellement avec des biologistes. Face à la complexité du mystère, nous avons dû solliciter des géologues et des paléoclimatologues.
Quel a été votre rôle en tant que réalisateur ?
Ma fonction sur cette mission s'apparentait à celle d'un chef d'orchestre. Imaginez 30 membres d'équipage sur le navire principal, une dizaine sur la barge, sans compter mon équipe de tournage. Mon travail consistait à coordonner l'ensemble pour que ma caméra se trouve au bon endroit au moment opportun et capte des scènes significatives, tout en maintenant le contact avec Laurent Ballesta.
Comment avez-vous communiqué avec Laurent Ballesta, immergé dans le module, à 120 mètres de profondeur ?
Nous avions déjà vécu cette situation sur Planète Méditerranée. Nous savions que la plongée en saturation nous empêchait de filmer l’équipe directement. La configuration s'apparentait à celle d'une émission de télé-réalité : des personnes isolées dans un espace inaccessible au réalisateur et à ses caméras, hormis via des dispositifs préinstallés. Nous avons donc déployé un système de petites caméras dans chaque module pour capter tout ce qui s'y déroulait, entendre et interagir avec ceux qui s’y trouvaient. La particularité supplémentaire résidait dans l'atmosphère d'hélium qui déformait leurs voix. Nous avons dû recourir à un traitement technique spécifique pour les comprendre. Le dispositif s'apparentait à celui d'un concert ou d'une émission télévisée, avec un technicien gérant plusieurs caméras simultanément. De mon côté, j'opérais avec une unité mobile entre les embarcations, interrogeant les chercheurs et réalisant des prises de vue aériennes.
Quelles sont les spécificités techniques d'un tournage subaquatique comme celui-ci ?
Notre chef opérateur, Roberto Rinaldi, s'immergeait pour filmer tandis que Laurent Ballesta capturait des images fixes. Deux plongeurs techniques les assistaient dans leurs tâches. En tant que moniteur de plongée, j'ai également pu réaliser quelques séquences à des profondeurs modérées (de dix à vingt mètres). Pour l'enregistrement, nous utilisions des caméras RED et Sony équipées d'optiques cinéma. Les avancées technologiques permettent aujourd'hui de filmer en 8K à 120 mètres sous l'eau – un progrès considérable par rapport à l'époque de Jacques-Yves Cousteau, où ces profondeurs exigeaient un éclairage intense. La sensibilité actuelle des capteurs et les performances des objectifs garantissent une excellente qualité d'image à grande profondeur. Néanmoins, chaque prise de vue sous-marine nécessite un éclairage approprié. Sans cet apport lumineux, l'environnement n'offre que des teintes bleues avec quelques variations de blanc et noir. À 120 mètres, le phénomène s'accentue, car le spectre lumineux se dégrade progressivement avec la profondeur. Les teintes rouges disparaissent en premier, et laissent place aux verts et bleus. Seul un éclairage artificiel révèle véritablement la beauté chromatique des lieux – un art que Laurent maîtrise parfaitement en photographie grâce à ses flashs. En vidéo, l'exercice s'avère plus complexe.
Quels sont les défis d'un tournage en profondeur ?
La pression (13 bars) représente un risque certain, bien que la technique soit aujourd'hui maîtrisée, comme elle l'était déjà à l'époque de Cousteau. Cependant, la moindre imperfection, ne serait-ce qu'un cheveu sur un joint torique, peut provoquer une infiltration d'eau et endommager irrémédiablement l'équipement. Cette mésaventure nous est arrivée, comme à tous les tournages sous-marins. Par exemple, Roberto Rinaldi avait protégé sa caméra dans un caisson étanche muni d'un moniteur pour faciliter le cadrage. Malheureusement, une fissure dans la vitre a provoqué une infiltration, le privant de son appareil principal dès le deuxième jour. Autre incident : nous avions conçu un système sophistiqué – un caisson avec caméra et optique performante – pour des travellings sous-marins. La vitre a implosé en cours d'utilisation, probablement à cause d’un impact. Nous avons perdu cette installation, fruit de six mois de développement, ce qui illustre les difficultés inhérentes à ce type de prise de vue.
Finalement, êtes-vous parvenus à expliquer le mystère des anneaux du Cap Corse ?
Trente-cinq chercheurs ont contribué à ce projet. Le paléoclimatologue Édouard Bard, qui supervisait les travaux, a effectué des datations révélant que ces formations remontent à 21 000 ans. Les analyses rigoureuses feront l'objet d'une publication scientifique prévue pour 2026. L'investigation a suivi une méthodologie académique stricte. Certains aspects de l'énigme demeurent toutefois inexpliqués. Les recherches se poursuivent avec de nouvelles analyses en perspective. Le documentaire présente les conclusions actuelles et propose l'hypothèse la plus probable à ce jour. Si certains éléments sont désormais établis, comme l'âge des cercles, d'autres aspects, notamment leur forme circulaire, relèvent encore de la théorie.
Cap Corse, le mystère des anneaux
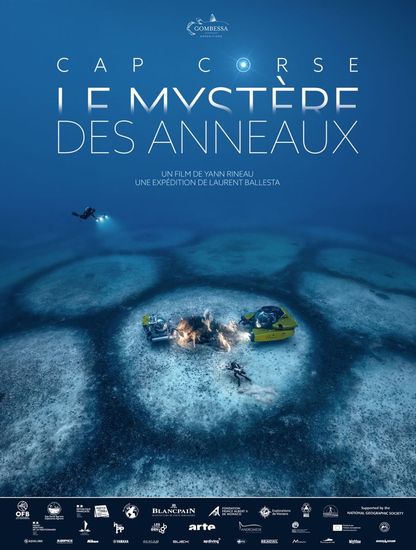
Documentaire disponible jusqu'au 02/08/2027 sur Arte.tv et la chaîne YouTube ARTE
Réalisé par Yann Rineau
Écrit par Yann Rineau, Laurent Ballesta et Aurine Crémieu
Coproduit par ARTE France, Les Gens Bien Productions, Andromède Océanologie
Le documentaire a bénéficié du Fonds de soutien à l’audiovisuel (automatique) du CNC.