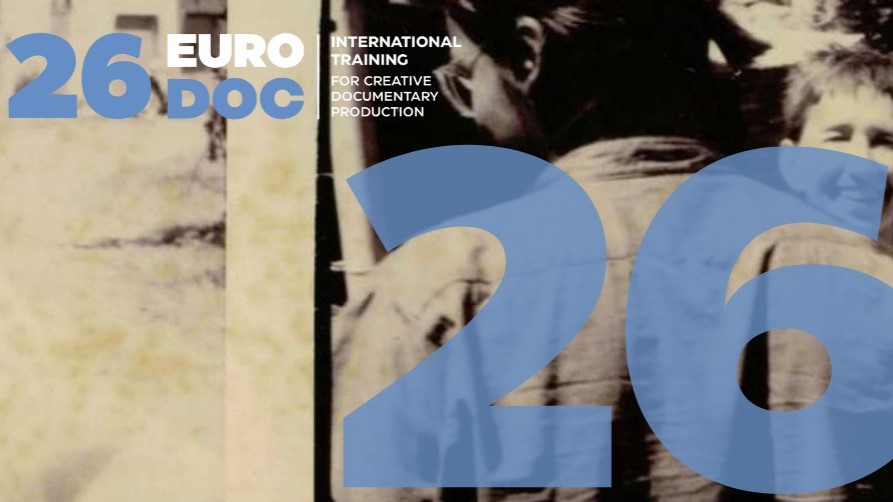Comment est né ce documentaire ?
Olivier Husson : Le projet est né l’année dernière avec l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), coproducteur du film. C’est lui qui m’a fait découvrir les recherches innovantes de Sophie Bonnet. S’est mis en place un travail de longue haleine, une collaboration étroite avec Sophie pendant trois ans. Cela nous a permis de travailler ensemble sur le fond et sur la science, parce que moi je ne suis pas scientifique, même si j’ai coécrit un film pour Arte sur les microplastiques et nanoplastiques dans le corps humain. J’ai des bases scientifiques, mais il me manquait la connaissance et la conscience de toute cette diversité et de la complexité de cet univers océanique qui nous échappe encore grandement. Je crois que c’est intéressant que ce genre de sujet soit traité par quelqu’un qui n’est pas un grand spécialiste, dans un esprit de vulgarisation. Cela permet d’avoir un certain recul. Mais cela demande aussi beaucoup de travail en amont pour se mettre à niveau de la spécialité.
Qui est Sophie Bonnet ?
C’est une océanographe de l’Institut méditerranéen d’océanologie (MIO), qui planche depuis une quinzaine d’années sur les océans chauds, tropicaux, connus pour ne pas participer – ou très peu – au piégeage du carbone par les océans. Du moins, c’est ce que l’on croyait. Elle est en passe de démontrer que ces océans capteraient plus de carbone qu’on ne le pense, grâce à une espèce très spéciale : le phytoplancton diazotrophe, qui permet l’éclosion de foyers de vie dans certaines conditions, à certains endroits des océans chauds. Ce que Sophie appelle des « oasis ». Une manière de présenter les océans tropicaux comme des déserts… jusqu’à un certain point, évidemment. Ce sont des recherches très novatrices, car la communauté scientifique considérait jusque-là que ce phytoplancton n’avait pas la capacité de piéger le carbone au fond des océans. Mais avec la mission « Hope », Sophie Bonnet commence à démontrer qu’une partie de la population de phytoplanctons diazotrophes finit bien par couler au fond de l’océan et piéger une quantité de carbone bien plus importante qu’on ne l’imaginait.
Où avez-vous filmé ?
On a suivi une expédition au large de la Nouvelle-Calédonie. Sophie est installée là-bas depuis quelques années pour ses recherches. On est partis en mer pendant près de deux semaines. On a filmé des séquences à terre avant, puis on a posé la caméra sur le bateau, et on a suivi le quotidien de l’équipe, toutes leurs manœuvres, le déploiement et la récupération des lignes de 700 mètres qui se posent au fond de l’océan, avec 32 capteurs.
Quelles sont les contraintes d’une production comme celle-là ?
Pour filmer les fonds marins, on ne pouvait pas le faire nous-mêmes : on n’avait pas les moyens. Notamment parce que la mission n’utilisait pas de sous-marin. Donc on a repris des archives de l’Ifremer dans le film. On disposait aussi de toutes les archives de l’IRD, qui a un pôle audiovisuel très développé. On a pu puiser dans tout cela pour nourrir le documentaire. On a tout de même fait quelques prises de vues sous-marines nous-mêmes, mais pas en dessous de dix mètres de profondeur.
Comment avez-vous travaillé l’équilibre entre la rigueur scientifique et la dimension narrative ?
C’est une vraie question qu’on se pose à chaque instant : parvenir à saisir ce qui se passe dans toute son authenticité, et en même temps, réussir à rendre cela intelligible pour le public. Ce sont des recherches hyper pointues. Il faut savoir remettre tout cela en perspective et illustrer par l’image ce que disent les scientifiques, qui parlent une langue qu’on ne comprend pas facilement. Il faut trouver le bon compromis : rester fidèle à la science, tout en rendant le propos accessible.
Quels messages cherchent à faire passer le film ?
Ce qui est très important pour Sophie et son équipe, c’est qu’il n’y a pas d’intentionnalité. Ils ne cherchent pas à démontrer quelque chose à tout prix. Ils montrent leur travail scientifique, et il en ressort ce qu’il en ressort. Il y a encore beaucoup de choses dans l’océan qui nous échappent et qu’on découvre petit à petit. Et c’est important, je crois, que le public perçoive le rôle majeur que jouent les océans sur terre, notamment face aux menaces du changement climatique.
Vous avez remporté le Prix du premier film scientifique au Festival international Pariscience. C’est une reconnaissance ?
C’est surtout une chance ! Ce prix nous a en effet été décerné en amont du tournage. Il a permis de financer la production du documentaire, car le projet lauréat est acheté par Ushuaïa TV pour diffusion.
Des oasis dans l’océan
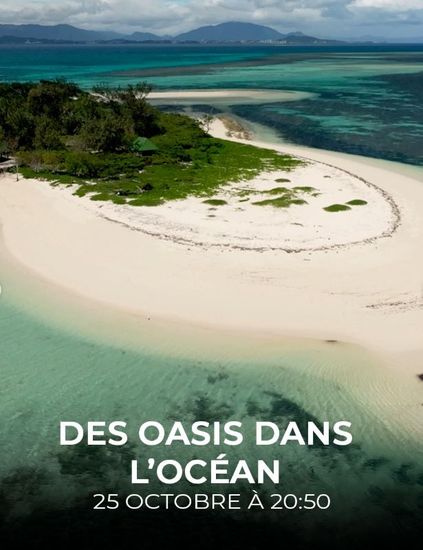
Documentaire diffusé le samedi 25 octobre 2025 à 20h50 sur Ushuaïa TV
Produit par : Découpages (Ségolène Dujardin) et Ushuaïa TV
Réalisé par : Olivier Husson
Auteur : Olivier Husson
Ce documentaire a bénéficié du Fonds de soutien audiovisuel (Aide à la production – automatique) du CNC. Il est projeté en avant-première le samedi 25 octobre à 16h15 au Festival Pariscience 2025.