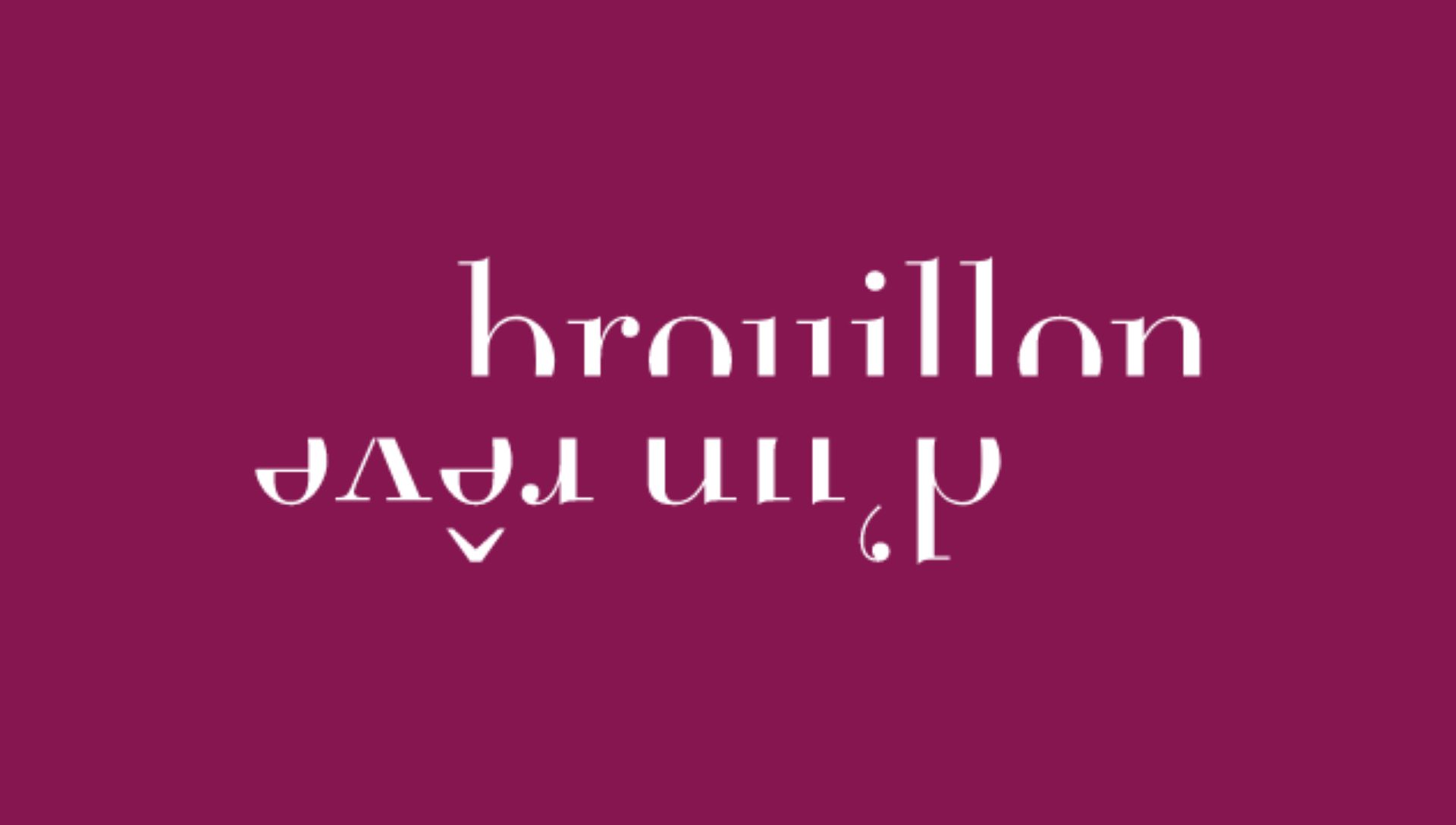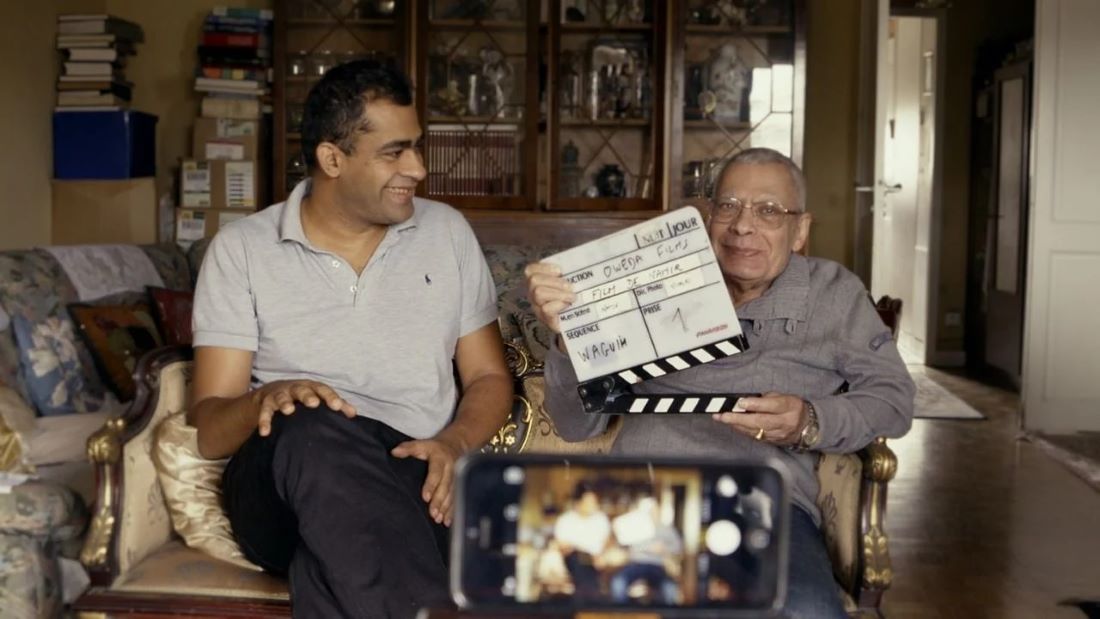Pouvez-vous nous présenter Ardèche Images ? Que fait concrètement votre association à Lussas ?
Sophie Salbot : Ardèche Images est une association créée en 1979 par Jean-Marie Barbe, avec pour objectif initial de produire et faire des films en région. L’idée était de développer le travail audiovisuel au plus près des territoires. Jean-Marie a mené toutes les démarches pour promouvoir la formation de producteurs et de réalisateurs en région, contribuant largement au développement de la présence de professionnels hors des centres urbains et à la mise en place des financements régionaux à travers la France.
Aujourd’hui, Ardèche Images structure ses activités autour de plusieurs axes. D’abord une école qui travaille en lien avec l’université de Grenoble et co-construit un master avec deux options : réalisation documentaire de création et production documentaire de création. S’y ajoute la formation continue avec des résidences d’écriture développées au fil des années. Ardèche Images, ce sont aussi les États généraux du documentaire, l’un des rendez-vous majeurs du documentaire en France. Sa vocation est double : être présent et compter dans le monde du documentaire professionnel, tout en marquant son ancrage territorial. Nous nous attachons également à la diffusion à l’année sur le territoire ardéchois. L’association gère enfin la Maison du doc, lieu historique d’accès aux films avant la numérisation, dont nous repensons actuellement la vocation.
Fabienne Hanclot : Il faut ajouter la formation des amateurs : Ardèche Images conçoit et anime une quinzaine d’ateliers de pratiques amateurs tout au long de l’année. Nous gérons aussi DocFilmDepot, une plateforme de gestion de festivals utilisée par une vingtaine de festivals documentaires en France et à l’étranger.
Article sur le même sujet
Comment cette association créée en 1979 est-elle devenue l’un des cinq pôles d’excellence Image de la région Auvergne-Rhône-Alpes ?
Sophie Salbot : Cette évolution découle naturellement de l’histoire que nous venons de raconter. Le fait de réunir toutes ces activités, mais aussi d’être à l’initiative de projets innovants comme la plateforme Tënk – une audace de Jean-Marie à laquelle peu croyaient au départ – a créé une force d’attraction. Les activités de Lussas ont attiré des professionnels qui ne se seraient jamais installés dans un petit village autrement. Ce pôle d’excellence s’incarne aussi physiquement dans le bâtiment L’Imaginaire, construit par la communauté de communes sous l’impulsion de Jean-Marie Barbe. Ce lieu participe du « village documentaire » que nous développons. Notre ambition dépasse le lieu physique : nous voulons faire de Lussas un espace de pensée qui permette au documentaire de vivre et lance des débats. Cette ambition s’inscrit dans un contexte difficile. Le documentaire et le cinéma indépendant font face à des forces contradictoires. Nos activités dépendent largement du soutien des collectivités territoriales, un soutien qui n’est plus toujours acquis et de plus en plus remis en cause. Promouvoir ce pôle d’excellence, c’est marquer sa nécessité et lui donner plus de force.
Fabienne Hanclot : L’impact territorial est remarquable. Le village de Lussas a vu sa population passer de 500 à 1200 habitants en dix ans. Cette dynamique tient à la présence de Tënk et Ardèche Images, avec des salles de montage, un auditorium de mix unique en région, des studios de postproduction. Beaucoup d’étudiants s’installent après leur formation autour de Lussas ou en région, créant une véritable économie locale : 50 salariés travaillent aujourd’hui dans le bâtiment. Jean-Marie Barbe a conçu toute la chaîne, de la formation à l’écriture jusqu’à la diffusion digitale. Le pôle d’excellence réunit tous les métiers du documentaire dans un même lieu, générant une forte attractivité économique. Le village vit désormais largement grâce à cette activité.
Le pôle documentaire s’agrandit avec le projet France 2030. Pouvez-vous nous expliquer ce que représente ce projet « 2030 – École documentaire » ?
Fabienne Hanclot : Le défi consiste à rester fidèle à notre identité – le documentaire d’auteur – tout en élargissant notre offre. Nous formons des jeunes et nous voulons qu’ils s’insèrent dans le milieu professionnel. Nous disposons déjà de solides dispositifs d’insertion, puisque nous sommes la seule école permettant de travailler sur le « film d’après » et de trouver des producteurs pendant le cursus.
Lussas a toujours innové, toujours eu une longueur d’avance. L’idée était de rester en veille sur les besoins du secteur et sur ce dont ont besoin les jeunes que nous formons. Le cinéma documentaire attire de plus en plus la jeune génération, il faut donc l’accompagner pour que les récits soient diffusés le plus largement possible. Le projet France 2030 vise d’abord à monter en gamme sur nos formations techniques, notamment autour du sonore et du documentaire sonore. Mais nous développons aussi nos spécificités : notre expertise en programmation, médiation et travail en milieu rural. Nous créons donc de nouvelles formations sur la diffusion des films et le développement des publics, particulièrement en milieu rural. Cet enjeu est d’autant plus important que le public des États généraux a une moyenne d’âge de 28-35 ans. Nous avons vendu 23 000 billets l’année dernière avec une majorité de jeunes. Nous savons travailler avec des publics jeunes sans céder sur l’exigence du cinéma que nous défendons.
Ce changement d’échelle pose des questions de cofinancement et de construction, mais l’enjeu est considérable. Sur le département de l’Ardèche, nous sommes les seuls lauréats France 2030 du secteur culturel. Cette inscription régionale d’un projet national génère des retombées positives fortes localement.
Les premières formations lancées portent sur la création sonore. Pourquoi ce choix ?
Fabienne Hanclot : Nous avons d’abord consolidé les formations existantes en ajoutant des modules son et postproduction au master. Cette année, nous lançons deux nouvelles formations autour de la création sonore. Suivront des formations sur la diffusion et le développement des publics, puis sur l’administration de production spécifique au documentaire. Le choix du son répond à un constat : les réalisateurs manquent de capacité à dialoguer avec les professionnels du son. Il faut mieux former les cinéastes sur ces métiers. La formation avec Benoît Bories sur la création sonore répond aussi au développement de l’univers des podcasts.
Sophie Salbot : Produire un film documentaire avec des budgets contraints se fait souvent au détriment de la postproduction, parce qu’elle n’est pas pensée en amont. Nous voulons faire comprendre aux réalisateurs et au milieu professionnel l’importance de la postproduction : elle a des incidences artistiques et des conséquences pour la vie future du film. Depuis vingt ans, les réalisateurs partent avec leur caméra sans penser à l’après, par nécessité d’agir immédiatement. Mais on oublie les conséquences des actes qu’on fait en filmant. Ce n’est pas qu’une question technique, mais artistique. Souvent, la question du son reste annexe, alors que c’est la faiblesse principale des rushes. Le son est pourtant un vecteur de création artistique majeur. Le film prend sa dimension pleine quand le montage et le mixage révèlent sa richesse sonore. Cette réflexion reste trop souvent basique. Développer la formation au son, c’est donner de l’ampleur aux films et faire reconnaître les documentaires pour ce qu’ils sont : des films à part entière, riches en images et en sons.
France 2030 mise sur la décarbonation et les acteurs émergents. Comment intégrez-vous ces enjeux environnementaux et de diversité ?
Sophie Salbot : Rappelons d’abord une évidence : le documentaire est naturellement proche de ces enjeux. Le cinéma est souvent pensé à partir de la fiction, mais nous pratiquons un cinéma sobre et en avance sur ces questions.
Fabienne Hanclot : Concrètement, France 2030 nous a permis de financer en partie l’installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment, en partenariat avec la communauté de communes. Nous sommes désormais en autoconsommation pour l’ensemble du bâtiment. Nous avons intégré un module de formation à l’écoproduction dans le master et la formation aux fondamentaux de la production. La ruralité impose ses contraintes : nous sommes dans le seul département sans train, dans un village sans borne électrique. Nous négocions avec les élus locaux pour installer une borne électrique et investir dans des véhicules électriques. Nos pratiques quotidiennes reflètent cette approche environnementale. Pendant le festival, nous avons organisé un transport en commun depuis la gare de Montélimar. L’absence d’aéroport règle la question de l’avion : tous nos invités viennent en transport en commun depuis Paris.
Quel budget représente ce projet France 2030 pour Ardèche Images ?
Fabienne Hanclot : La dotation reçue s’élève à 680 000 euros.
Sophie Salbot : Une question importante de France 2030 concerne le financement privé : comment nos activités peuvent-elles trouver des partenaires privés ? L’enjeu reste majeur. Nous faisons face à un paradoxe : la vitalité de Lussas bénéficie du mouvement de retour vers le rural – de nombreux jeunes s’installent ici – mais les grandes infrastructures se désengagent. Nous espérons dialoguer avec des structures comme la SNCF pour inverser ce désengagement du réseau ferroviaire national. Notre militantisme s’exprime là : défendre la culture en milieu rural. La culture, ce n’est pas que les centres urbains. Nous portons une culture exigeante et nous ne rabattrons pas nos ambitions pour conquérir le public local. Nous voulons faire comprendre aux partenaires privés que nous accompagner a du sens, car nous incarnons les enjeux territoriaux de demain.
Comment ce projet s’articule-t-il avec votre écosystème : Tënk, DocMonde, Les Films de la pépinière ?
Fabienne Hanclot : La collaboration est étroite, notamment avec Tënk et tous les outils présents sur place : auditorium de mixage, studios de postproduction.
Sophie Salbot : Cet écosystème découle de la création d’Ardèche Images. Les formations à l’étranger se sont autonomisées avec DocMonde, Tënk a émergé, tout est né de cette initiative fondatrice de Jean-Marie Barbe.
Quelle est votre spécificité pédagogique, notamment ce lien au territoire ?
Fabienne Hanclot : Chaque année, nous accueillons 12 étudiants en réalisation et 6 en production sur le master, plus environ 80 étudiants sur l’ensemble des formations continues. Les étudiants en réalisation tournent trois films dans l’année, dont un film de fin d’études. Nos consignes sont claires : le documentaire, c’est l’art de la rencontre. Nous encourageons nos étudiants à aller vers l’autre – agriculteur, viticulteur, monde rural. Cette rencontre des mondes correspond à notre projet originel : attirer les professionnels des grands centres urbains tout en travaillant le territoire.
Nous développons une mémoire audiovisuelle de trente ans. Nous travaillons sur les archives amateurs du territoire. Notre collecte d’archives a donné lieu au premier épisode d’une série documentaire – quarante ans d’archives filmiques sur la communauté de communes. Nous organisons de nombreux ateliers où enfants et adultes travaillent sur les archives de leurs familles. Notre responsabilité d’acteur culturel en milieu rural est d’influencer la façon dont le public regarde les images. Nous formons du CM2 aux adultes en difficulté sur cette question : quel récit construire aujourd’hui à partir d’images d’archives ? Comment déceler la manipulation d’un récit ? La formation professionnelle reste toujours liée à la formation des publics et des amateurs. Les regards s’éduquent.