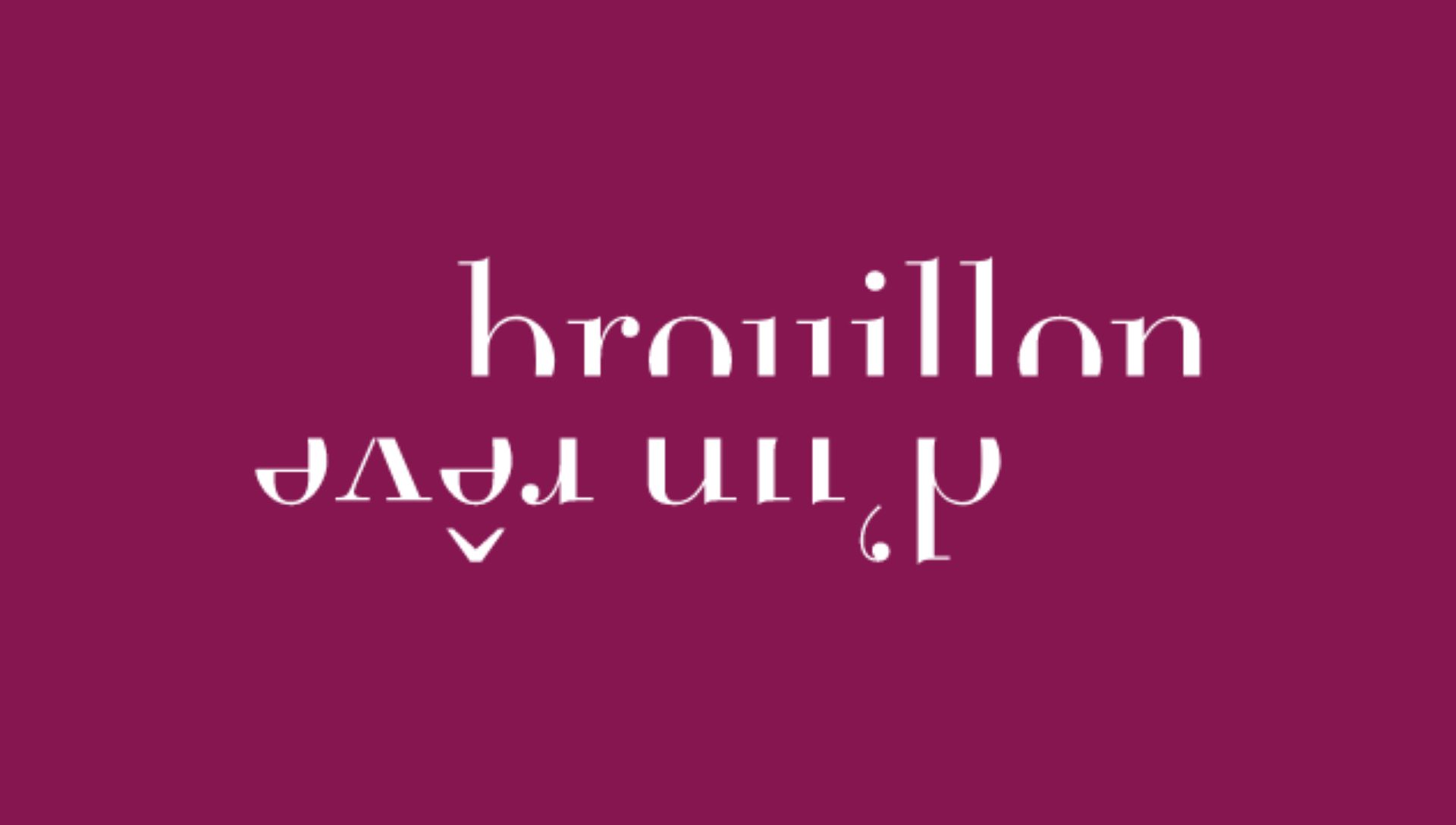Racontez-nous la genèse d’Imago.
Déni Oumar Pitsaev : L’idée de ce film est née en 2018, lorsque mon cousin Daoud m’a proposé de venir passer un été au Pankissi, en Géorgie, pour que je renoue avec mes origines. Il estimait que j’avais passé trop de temps à l’étranger. Je lui ai répondu en rigolant que j’accepterais seulement si je pouvais en faire un film. Sauf que ma blague a pris de l’ampleur : l’année suivante, ma mère m’a acheté une terre dans cette vallée pour m’inciter à m’y rendre, et en 2020, mon père m’a contacté pour m’aider à y construire une maison. Ce projet s’est développé petit à petit, jusqu’à devenir le film qu’il est aujourd’hui.
Vous arrivez au Pankissi avec l’ambition d’y construire une maison montée sur pilotis, ce qui vous vaut quelques taquineries de votre entourage… Pourquoi ce choix ?
C’était un rêve d’enfant. Je n’ai pas eu de maison quand j’étais petit, donc je m’étais promis qu’un jour, j’en construirais une. Et pas n’importe laquelle : une maison qui flotte, construite en verre. Plus jeune, je n’ai pas beaucoup vu le soleil car les bombardements m’obligeaient à descendre régulièrement dans les caves des immeubles pour me protéger. Je voulais donc une maison sans cave, qui laisse entrer la lumière. C’était un moyen pour moi de faire fuir la guerre.
Quelle place avez-vous laissée à l’imprévu, une fois la caméra allumée ?
Le film était très écrit. Les dispositifs français de soutien au cinéma nécessitent de décrire son projet de manière détaillée, même lorsqu’il s’agit d’un documentaire. D’ailleurs c’est grâce à l’aide à l’écriture d’un projet de long métrage du CNC, que j’ai pu bénéficier d’une co-autrice, Mathilde Trichet, afin d’aller plus loin dans l’écriture, de prendre le temps, de tester des choses.
Aidé par mes repérages et mes connaissances des personnages, j’ai dû imaginer comment les scènes se dérouleraient, afin de retranscrire au mieux la dramaturgie du film. Le dossier faisait plus de 140 pages remplies de suppositions. Quand je suis arrivé sur place, j’ai laissé l’écrit de côté car il fallait embrasser le réel. Et il s’est révélé plus riche que prévu !
Combien de temps le tournage a-t-il duré ?
Nous avons tourné dix semaines, réparties sur deux périodes. Notre tournage a été scindé en deux à cause des complications géopolitiques. Les premières prises de vues ont été avortées suite au déclenchement de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Les frontières entre la Géorgie et la Russie étant désormais filtrées afin d’empêcher les hommes russes de fuir le service militaire, mon père – qui habite en Russie – ne pouvait pas me rejoindre. Cette première session s’est transformée en repérages filmés, tandis que le véritable tournage s’est déroulé plus tard, à l’été 2024.
Une fois sur place, de quelle manière s’est mis en place votre dispositif documentaire ?
Puisque j’allais beaucoup en demander aux habitants ainsi qu’à ma propre famille, j’ai rapidement compris qu’il fallait que je me place au même niveau qu’eux. Que je devienne moi-même un personnage, pas seulement l’homme derrière la caméra. Je ne voulais pas qu’une machine s’installe entre nous, ou bien il aurait été impossible de dialoguer et de faire parler les corps. J’ai donc décidé de ne pas filmer moi-même et de m’entourer d’une équipe.
Les personnes que vous filmez ont-elles fait preuve de résistance ?
Au départ, les jeunes se sont montrés méfiants. J’ai dû les rassurer à plusieurs reprises sur le fait que je n’étais pas un journaliste, mais bel et bien un cinéaste. Pour eux, quelqu’un avec une caméra est forcément journaliste. Qualifié de « vallée des djihadistes », cet endroit a longtemps souffert d’une mauvaise réputation et beaucoup de reporters venaient avec des images en tête qu’ils voulaient fabriquer. Mais lorsque les locaux ont compris que j’étais moi-même tchétchène, ils sont tous devenus très bienveillants. Qu’ils ne prennent pas mon film au sérieux a aussi beaucoup aidé : ils pensaient tous que le sujet n’intéresserait personne.
Vous ne cachez pas au spectateur qu’il est en train de visionner la fabrication du documentaire. Pourquoi ?
Il était important que le spectateur puisse voir le film se créer devant ses yeux afin de trouver sa place au sein du dispositif. J’ai donc décidé de tracer une frontière entre le champ et le hors-champ, entre vie privée et vie publique, de sorte que le spectateur ne se sente pas pris au piège dans une affaire familiale très privée. Briser le quatrième mur me permettait d’être transparent vis-à-vis de ceux que je filme et de ceux qui regardent.
Quelle était la ligne directrice au montage ?
Faire le deuil des belles images. Les 70 heures de rushes avaient de nombreuses qualités esthétiques, mais avec mon monteur, Laurent Sénéchal, nous nous sommes rapidement accordés sur un montage guidé par les émotions. Les tremblements, le cadrage approximatif, des séquences trop longues : tout ça n’avait pas d’importance, tant que l’émotion était juste. Pour éviter de tomber dans une image de carte postale, j’avais déjà délibérément fait le choix d’écarter la nature luxuriante du cadre en utilisant le ratio 1 : 1.5. Ce format est le même que celui des photos d’album des années 90. Comme j’ai perdu toutes celles de mon enfance dans les bombardements, je voulais faire de mon film une sorte d’album familial.
Quelle scène vous a donné le plus de fil à retordre ?
Dès l’écriture, je savais que je voulais la scène finale avec mon père dans la forêt puisque la narration d’Imago se construit pour arriver à cette séquence. Aucun dialogue n’était fabriqué, j’avais seulement décrit ce père que je connaissais à peine comme quelqu’un de taiseux et de pudique. Ce qui était loin d’être vrai ! J’ai rapidement découvert que mon père parlait énormément et notre interaction s’est révélée beaucoup moins silencieuse que ce que j’imaginais… Au départ, son assurance m’a perturbé.
Nous avons tourné une seule fois, sur deux heures, avec comme seules pauses les changements des cartes et des batteries du matériel. C’était un travail physique pour mes collaborateurs artistiques, qu’il s’agisse du chef opérateur ou de l’ingénieur du son, car nous filmions sur des collines escarpées et dans une forêt qui grouillait d’insectes. C’était aussi très difficile pour moi, car je devais assumer sur une durée assez longue cette double casquette de protagoniste et de réalisateur.
Bien qu’Imago soit une production franco-belge, son identité résolument tchétchène lui a valu d’être qualifié de « premier film tchétchène présenté à Cannes ». Comment avez-vous vécu cette expérience ?
Je suis arrivé à Cannes complètement épuisé. La postproduction avait été très sportive : l’étalonnage avait eu lieu à Paris en même temps que le mixage à Bruxelles. J’étais également très stressé de présenter le film devant un public, Imago étant un récit très personnel. Le passage à Cannes était tellement intense que je n’en ai pas pleinement profité. Une fois la pression retombée, j’ai réalisé à quel point ce petit film avait pris de l’ampleur.
IMAGO
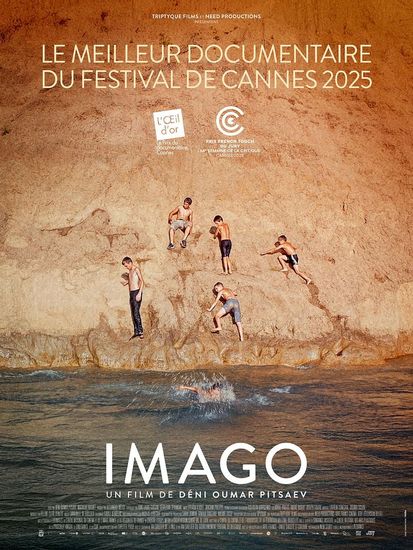
Réalisation : Déni Oumar Pitsaev
Scénario : Déni Oumar Pitsaev, Mathilde Trichet
Image : Joachim Philippe et Sylvain Verdet
Montage : Laurent Sénéchal et Dounia Sichov
Production : Triptyque Films en coproduction avec Need Productions
Distribution : New Story
Sortie le 22 octobre 2025
Soutiens sélectifs du CNC : Soutien au scénario - aide à l'écriture 2021, Avance sur recettes avant réalisation, Aide sélective à la distribution (aide au programme 2025)