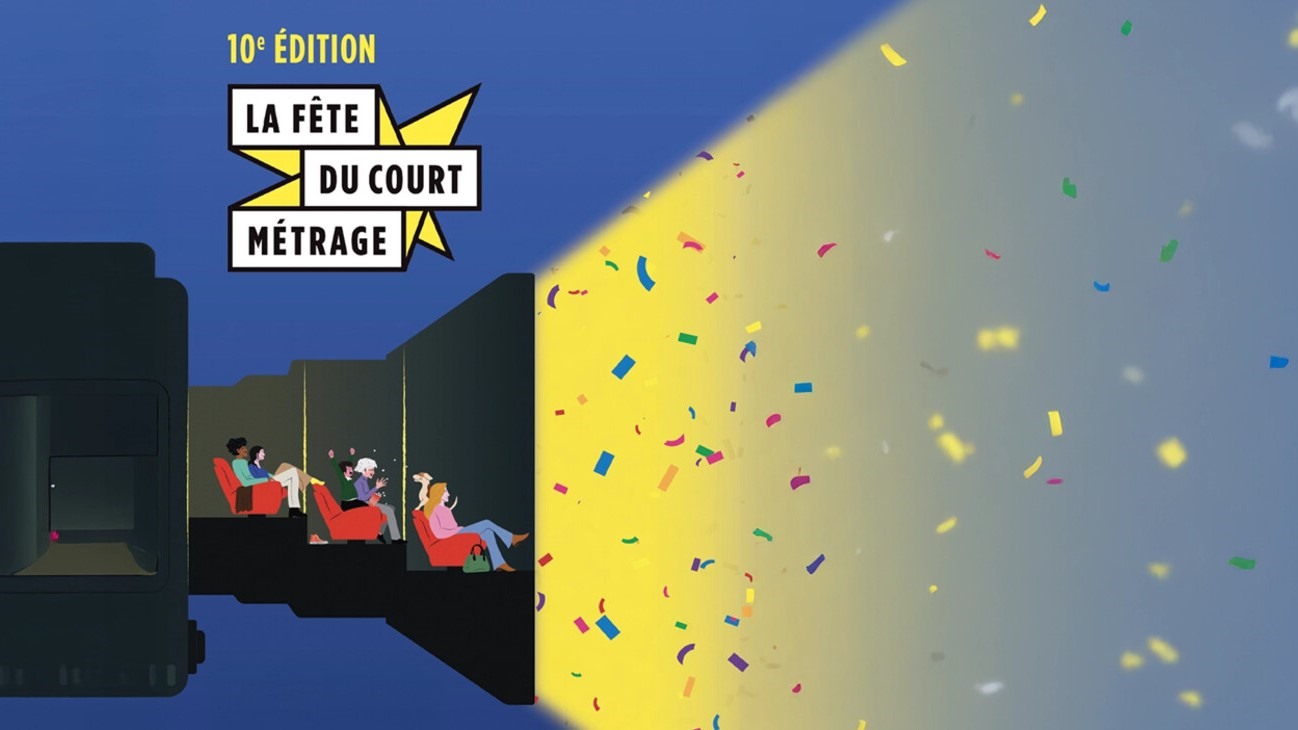Vous cosignez le scénario de cette comédie autour de réfugiés syriens installés dans un village breton avec Matthieu Rumani, Nicolas Slomka et Léa Domenach… Comment s’est articulée cette collaboration ?
Julie Delpy : Le sujet que je voulais traiter demandait un important travail d’enquête. Mon producteur Michaël Gentile (The Film) m’a donc proposé d’écrire en équipe. Il fallait étudier concrètement la façon dont les réfugiés sont accueillis en France, les difficultés qu’ils rencontrent, les étapes de leur intégration... Seuls les principaux concernés pouvaient nous faire partager cette expérience. Matthieu Rumani et Nicolas Slomka m’ont ainsi aidée à recueillir des témoignages de femmes et d’hommes rencontrés via des associations dédiées. Bien que nous soyons sur le ton de la comédie, je voulais que tout ce qui se passe dans le film s’appuie sur la réalité. L’écriture reposait sur une structure clairement définie au départ. Nous nous sommes ensuite réparti tous les trois des séquences et avons avancé chacun de notre côté. Nous échangions en permanence nos idées grâce à de constants allers-retours. Les Barbares est un film choral où chaque personnage devait exister au-delà de l’image qu’il renvoie de prime abord, chacun possédant une fantaisie plus ou moins secrète. Dans cette histoire les personnages sont très nombreux, réussir à les faire coexister sur le papier a été un travail de longue haleine. Une fois la première version du scénario écrite, nous avons demandé le soutien de Léa Domenach, dont la fraîcheur du regard nous a permis de rééquilibrer les choses.
Vous évoquez « une structure clairement définie », quelle était-elle ?
Cette histoire devait présenter une multiplicité de points de vue sans qu’aucun d’entre eux ne soit privilégié par rapport à un autre. Il y a d’un côté les habitants de Paimpont, le village breton où nous avons tourné, de l’autre, la famille syrienne. Chaque groupe a des individualités dont il fallait tenir compte. Cette volonté d’équilibre était notre pilier. Ici tout le monde se pose des questions sur le mode de vie de l’autre, tout le monde a des doutes, des préjugés… Par ailleurs, je ne voulais surtout pas donner le sentiment de prodiguer des leçons à qui que ce soit, ni tomber dans une surenchère de bons sentiments. Enfin le genre de la comédie me permettait d’apporter une certaine tendresse à laquelle je tenais. L’émotion, l’action et le rire cohabitent ici en permanence. C’était un sacré défi, et ce dès l’écriture. Avec mes partenaires, il a fallu définir le ton qui nous paraissait juste et ne pas le lâcher.
C’est-à-dire ?
L’idée de choisir une famille de réfugiés syriens plutôt souriante qui a envie de s’intégrer allait à l’encontre du cliché véhiculé dans la plupart des fictions ou dans les reportages télévisuels. Le réfugié y est souvent présenté comme un individu solitaire qui flirte du mauvais côté de la loi pour s’en sortir, qui est une potentielle menace pour la société. En allant sur le terrain, nous avons surtout rencontré des médecins, des artistes, des architectes, obligés de fuir et d’abandonner leur métier pour survivre. Prenez Fares Helou qui incarne le grand-père de la famille syrienne, c’est un acteur populaire dans son pays, contraint à l’exil. Craignant pour sa sécurité, car opposé au régime de Bachar el-Assad, il a demandé l’asile politique à la France en 2011.
Durant l’écriture du film, l’invasion des troupes russes en Ukraine a engendré le déplacement de milliers de personnes. En quoi cette actualité a-t-elle influé dans votre écriture ?
Elle est arrivée à un moment de gros doute concernant la faisabilité du film. Soudain cette guerre nous a apporté un éclairage particulier. Nous sentions dans le monde entier, et la société française en particulier, une grande empathie pour ces Ukrainiens obligés de quitter précipitamment leur pays. Beaucoup de monde se disait prêt à accueillir des familles. Les réfugiés politiques syriens que nous avons interrogés, eux, nous expliquaient leur grande difficulté à se faire héberger. Ils déploraient également l’absence de curiosité par rapport à leur histoire. Or au même moment les journaux parlaient en détail de la situation ukrainienne… Comment expliquer ce « deux poids, deux mesures » ? D’où cette idée que faute de réfugiés ukrainiens disponibles, la commune de Paimpont voit débarquer une famille de Syriens. D’un coup, les habitants sont déçus, voire méfiants à leur égard.
Le titre de votre film, Les Barbares, est très fort. Comment l’interprétez-vous ?
Nous sommes tous le barbare de quelqu’un d’autre. Là aussi, tout est une question de point de vue. La peur nourrit des fantasmes et très vite la haine de l’autre. Dans l’imaginaire de la plupart des habitants du village, les Syriens sont forcément des êtres radicalisés qui vont détruire l’harmonie ambiante. Mais ils se rendent compte très vite qu’ils partagent les mêmes désirs, les mêmes besoins : dormir sous un toit, se rendre utile à la société, tomber amoureux… Ce n’est pas une vision angélique des choses. C’est la réalité et il fallait la raconter.
Parmi les villageois, les femmes agissent particulièrement pour faire bouger les lignes… Revendiquez-vous le caractère féministe de votre film ?
Là encore, nous nous sommes basés sur des faits. Les femmes sont beaucoup plus actives sur le terrain associatif. Il y a aussi des hommes bien sûr, mais ils sont minoritaires. Je n’ai pas de réponse à donner à ce déséquilibre, c’est juste une réalité. Par ailleurs, au sein des familles de réfugiés, il est plus facile pour une jeune fille de s’intégrer dans une classe que les garçons qui suscitent d’emblée un rejet. Pour les plus âgés, les femmes trouvent plus facilement du travail, acceptant des emplois qui ne correspondent pas forcément à leur niveau d’étude ou leur formation. Les hommes, eux, rechignent beaucoup plus. Alors oui, Les Barbares a une dimension féministe mais là encore, l’idée n’était pas de donner de grandes leçons sociologiques ou politiques, juste de raconter une histoire la plus juste possible.
En termes de mise en scène, comment avez-vous trouvé la bonne distance ?
Il fallait être le plus précis possible. Voilà pourquoi le processus d’écriture a été long. Un film choral nécessite de faire coexister des êtres, de n’oublier personne pour que chaque individualité influe sur le récit. Une mise en scène en surplomb aurait déstabilisé l’édifice, je reste au contraire à hauteur de mes personnages. Je donne ainsi l’impression au spectateur qu’il regarde un reportage, qu’il est au cœur d’un univers hyperréaliste. J’assume également un côté presque désuet dans ma façon de filmer ce village. Cela allait avec ce désir de tendresse que j’évoquais plus haut.
Vous vivez entre les États-Unis et la France. En quoi ce double regard vous a-t-il aidé dans la réalisation de ce film à l’ancrage très français ?
La culture anglo-saxonne est plus prompte à utiliser la satire pour parler de choses graves, elle n’hésite pas à oser la comédie, voire le burlesque... En France, il y a plus de retenue à ce niveau-là. Or j’aime explorer certains territoires sans forcément sombrer dans le drame qui peut avoir un aspect contre-productif. Si je vis aux États-Unis, je ne suis pas déconnectée de ce qui se passe en France. Les Barbares en est j’espère, la preuve.
Les Barbares

Réalisation : Julie Delpy
Scénario : Julie Delpy, Matthieu Rumani, Nicolas Slomka et Léa Domenach
Avec Julie Delpy, Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte…
Image : Georges Lechaptois
Montage : Camille Delprat
Musique : Philippe Jakko
Production : The Film (Michaël Gentile)
Distribution : Le Pacte
Ventes internationales : Charades
Sortie en salles : 18 septembre 2024
Soutiens du CNC : Aide au développement d’œuvres cinématographiques de longue durée, Aide à l'édition vidéo (aide au programme éditorial)